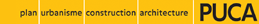Note parue dans le
Numéro 108
écrite par Erwan Le Méner
BARRERE C., LEVY-VROELANT C. - Hôtels meublés de Paris : enquête sur une mémoire de l’immigration, Créaphis, Coll. « Les lieux habités », Paris, 2012.
Paris compterait aujourd'hui plus de 21 000 chambres consacrées à l'hôtellerie « sociale » (en incluant les établissements de tourisme et les résidences hôtelières pratiquant l'hébergement social), dont 18 000 chambres dans des hôtels meublés (Apur, 2007). D'un côté, ces chiffres peuvent paraître considérables : en effet, depuis une quinzaine d'années, l'hôtellerie sociale est devenue, à Paris et plus largement en Île-de-France, le principal dispositif d'hébergement de familles que l'on pourrait dire « sans logement » – bénéficiant, en raison de la présence d'enfants, d'un hébergement institutionnel, financé sur les crédits de l'urgence sociale, de la demande d'asile, ou de la protection de l'enfance. De fait, l'espace des meublés est de plus en plus sollicité par le monde associatif, qui l'investit comme un hébergement d'urgence, à destination, en premier lieu, de familles sans logement. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi : Claire Lévy-Vroelant, qui travaille depuis les années 1990 sur le monde des meublés et des garnis, avait déjà montré l'importance de ces établissements dans le développement de Paris, depuis la Révolution industrielle. Les meublés ont servi de « logement de passage » (Lévy-Vroelant, 2000) à des migrants, français ou étrangers, essentiellement des hommes seuls, venus travailler à Paris, et y gagner une indépendance matérielle. Au début des années 1930, plus de 10 % des Parisiens y vivaient (Faure, Lévy-Vroelant, 2007). Cette indication invite donc à réévaluer la taille actuelle du parc de l'hôtellerie meublée (et sociale), qui rétrécit, sur la longue durée, comme peau de chagrin.
Avec la mutation du monde de l'hôtellerie meublée (tendant à fonctionner comme hébergement d'urgence), et de son peuplement (composé de façon croissante par des familles), c'est une histoire de la ville qui tend à s'effacer, mais aussi une mémoire de l'immigration. Céline Barrère et Claire Lévy-Vroelant proposent aussi de saisir les hôtels meublés comme des « lieux de mémoire » (p. 7). Toutefois, elles n'entendent pas consacrer des sites de commémoration, dans une veine muséographique qui a parfois marqué l'histoire de l'immigration. Dans une perspective « subalterniste » (p. 49) fécondée par les memory studies, elles explorent ces lieux comme des espaces habités, caractéristiques de l'expérience urbaine de migrants, « individus discrets et anonymes, conscients jusqu'à saturation de cette insignifiance » (p. 172).
La composition de l'ouvrage traduit le souci de tenir compte de l'ambivalence du meublé. Celui-ci est à la fois un espace de précarité, parfois d'injustice, dont la visibilité exceptionnelle, à l'occasion notamment d'incendies meurtriers, n'éclaire pas la vie quotidienne ; mais il est aussi un espace d'hospitalité urbaine peu visible et menacé de disparition. Dans une première partie, intitulée « Les récits et leurs silences », les auteures nous apprennent qu'elles ont fait connaissance avec des « clients anciens », maghrébins pour la plupart, qui vivent dans ces lieux depuis des années et pour un temps indéfini ; qu'elles sont parties à la rencontre d'hôteliers, eux-mêmes migrants ou enfants de migrants ; qu'elles ont enregistré leurs histoires, qui sont en même temps celles des lieux et de l'immigration d'après les indépendances. Elles ont constitué en parallèle un corpus littéraire, sur le thème des meublés, qui a enrichi leur compréhension des récits parcellaires recueillis. Nous reviendrons sur cette démarche originale. Les hôtels meublés sont abordés comme « Lieux et milieux » dans la partie suivante. On apprend que l'hôtel est vécu par ses occupants avant tout comme un point d'ancrage et d'ouverture sur la ville. Dans le parcours des migrants, il est aménagé comme une niche protectrice – Simon Harel parle de « moi-valise », Tahar Ben Jelloun de « chambre-malle », mais où l'on risque de tourner en rond, de laisser ou de perdre ses souvenirs et son histoire. Car l'on s'y installe parfois, cependant que l'on ne retourne plus chez soi, et sans « grand chose en échange » (p. 112). S'il est un lieu de surveillance, où l'habitant peut être soumis à des décisions arbitraires de l'hôtelier, et ce dernier floué par son client, il n'est pas moins un espace central de recomposition et d'extension du « familier », voire du familial. Il apparaît alors comme le terreau insoupçonné d'une activité de « Mémoire, (d')identité, (de) transmission », titre de la dernière partie de l'ouvrage. Les logés y traversent finalement l'exil par le « métissage » : des rencontres, des langues, des récits. Se dessinent alors des voisinages qui soutiennent des appartenances transnationales, pourtant mises à l'épreuve dans de telles conditions. Cet espace « vivant » complique une éventuelle patrimonialisation de ces lieux, amenés à disparaître. Un intérêt majeur de l'enquête est alors d'avoir su reconnaître là, non seulement les épreuves et les infortunes de la migration et de sa mémoire, mais également un « espace élastique, le nœud d'une enquête topographique et identitaire », vécu par le sujet lui-même comme « un lieu de mémoire de l'immigration » (p. 135).
L'ouvrage exerce un véritable effet de découverte, dû certainement à la méconnaissance de cet univers, mais aussi à la façon ingénieuse qu'ont les auteures de l'aborder. Elles conduisent tout d'abord, de façon classique, une série d'entretiens, répétés si possible, avec des logeurs et des logés, dans dix-huit hôtels de Paris et un établissement de Saint-Denis. Durant plus de deux années, de manière discontinue, elles réalisent une cinquantaine d'entretiens, participent à de nombreuses conversations ; leurs observations sont également consignées dans des carnets de bord, qui permettent de précieuses contextualisations des échanges. Tout se joue aux comptoirs – réceptions ou zincs. Ce sont en effet des espaces de sociabilité caractéristiques des meublés. Ils apparaissent par là comme le milieu (ie. « prétexte, source et contexte », p. 32) de l'activité mémorielle, de personnes « sans famille ni groupe autour desquels construire du souvenir collectif ensemble » (p. 20). Se maintient ainsi une communauté où sont conviées des mémoires individuelles et des histoires qui n'ont parfois en commun que l'expérience de colonisés. Les nombreux matériaux produits se relèvent pourtant fragmentaires. La remémoration est souvent difficile. Les auteures n'ont en main que des bribes d'histoires et des souvenirs hétéroclites. Elles buttent sur des réticences à parler davantage de soi et à se rappeler une histoire marquée de ruptures douloureuses, parfois traumatiques. Les chercheuses doivent apprendre à composer avec des silences, des discontinuités, et des ellipses. Elles refusent cependant de soutirer davantage la parole de leurs interlocuteurs. Elles considèrent, au contraire, que le délitement et l'éparpillement de cette matière mémorielle sont cela même qu'elles doivent étudier, qu'ils constituent la qualité et non le défaut des récits produits.
Mais alors, « ce qui est en cause, c'est la possibilité même de sa formulation et, partant, de son inscription dans l'espace social et dans la mémoire collective » (p. 8). Comment donc rapporter ce qui se retient dans la conversation, et va parfois jusqu'à se retirer de l'expérience présente ? Comment représenter une expérience du retrait, de la perte, parfois de l'absence et de l'oubli définitif ? Les auteures semblent se donner deux consignes pour ne pas « disqualifier » (p. 20) ou défigurer le sujet de l'histoire. Ces consignes apparaissent comme deux qualités d'écriture. Tout d'abord, elles s'efforcent de ne pas remplir les trous de mémoire par le (trop) plein d'une connaissance sociologique ou historique, qui resterait alors extérieure aux phénomènes qu'elle prétend étudier. Mais elles prennent également soin de ne pas élargir ces césures en faisant prévaloir les raccords du discours officiel sur l'immigration et les meublés, discours centré sur ce qui manquerait, ce qui ferait défaut, à l'expérience de l'immigré-client de l'hôtel : l'ancrage et la propriété ; l'histoire et l'habiter. La voie choisie par les auteures est tierce. Il s'agit de parcourir un « second espace testimonial » (p.11), celui de la littérature.
Céline Barrère et Claire Lévy-Vroelant ont alors cherché l'expression de cette expérience et de cette mémoire fragmentées mais pas moins sédimentées, chez des auteurs « (plaçant) le « je » et l'intime de l'expérience au cœur de leur discours » (p. 12). Elles ont compilé de façon systématique, à partir de la base Frantext, les passages de romans et récits intimes, publiés en français, contenant les termes « chambres d'hôtel » et « hôtel meublé ». Elles ont trouvé dans ce corpus une focalisation sur les moments de trouble, de rupture, épisodes ou remémorations violents, parfois humiliants. Elles ont ainsi enrichi leur regard sur ce qui amène les logés à vouloir oublier et ne pas parler, ou par des silences. Enfin, fortes de cette expérience via la littérature, elles ont pu trouver la distance adéquate avec les personnes rencontrées. Elles se sont rendu attentives aux « seuils » et aux « entrées en matière », qui organisent ces lieux et les socialités qui s'y développent. Cette approche à tâtons paraît rétrospectivement déterminante, tant le monde des meublé est classiquement dépeint comme celui de « l'étranger, toujours potentiellement menaçant » (p. 58). En s'intéressant moins à la question : « que révèle l'hôtel meublé de nos façons d'accueillir l'étranger ? » qu'à celle, plus rarement traitée, de savoir ce que produit le passage par ces établissements dans la vie de migrants, les auteures ont assurément permis d'avancer dans la compréhension de certaines expériences de l'hôtel et de leur place dans la vie de migrants. Les auteurs sollicités, tous francophones, mais du Maghreb et de la Caraïbe autant que de la France (de Rachid Boudjedra à Henri Lopes, de Louis-Ferdinand Céline à Driss Chraïbi, de Denis Laferrière à Claire Etcherelli, etc.) apportent leur témoignages de l'intérieur et les figures d'une littérature de l'exil.
L'originalité de la démarche mise en œuvre par Céline Barrère et Claire Lévy-Vroelant est remarquable, l'exploration d'expériences subalternes via la littérature ajoutant à la compréhension des récits en situation. En outre, cette démarche pourrait être certainement mise à profit dans d'autres milieux, caractérisés par leur vulnérabilité, leurs silences et leurs discontinuités. On peut toutefois regretter que ce dialogue entre la littérature et les récits de première main se soit fait, parfois, au prix de limitations de l'investigation in situ. Le monde des hôtels meublés, plus largement de l'hôtellerie sociale, est diversifié, comme le soulignent les auteures, selon le type d'établissement, d'hôtelier et de clientèle. Bien qu'elles précisent s'être intéressées, en particulier, aux meublés accueillant des Maghrébins et notamment des Algériens, cette réduction de focale n'abstient de considérer, au moins à titre d'hypothèse, les variations d'expérience, au sein des établissements, ainsi qu'entre les établissements étudiés. L'homogénéité de l'expérience de l'hôtel et de la mémoire collective de l'immigration, telle qu'elle est présentée, semble davantage portée par des recoupements récurrents dans le corpus littéraire que par les passages de récits présentés. L'enrichissement de l'expérience permis par la littérature (p.53-54) n'a-t-elle donc pas pour rançon une réduction des expériences rapportées ? Des entretiens ponctuels, répétés parfois, produisent bien évidemment des morceaux de récits, complétés astucieusement par des conversations et des observations sur place. Mais les chercheuses n'auraient-elles pas gagné à se perdre davantage dans les vies qui commençaient à leur être racontées ? Á revenir sur les lieux de ces rencontres, jusqu'à y tenir un rôle qui ne soit pas seulement celui de l'observateur de passage ? À accepter et rendre les invitations, sans décréter, par exemple, comme un principe, que pénétrer dans une chambre constituait de facto une intrusion dans l'intimité de son hôte ? Enfin, la finesse du regard porté sur le dedans de l'hôtel, caractérisé dans la littérature à la fois comme enfermement et protection contre l'extérieur, n'a-t-elle pas accentué l'effet de cloisonnement des vies à l'hôtel ? On comprend pourtant, au fil des pages, qu'il s'agit d'un lieu que l'on pourrait dire pivot : un point fixe, un ancrage mais aussi un champ de perspectives articulées avec son environnement. Partant, on aurait aimé que les chercheuses suivent des habitants d'hôtel dans la ville, parcourent avec eux les réseaux de migrants, les tissus de relations, de souvenirs et d'histoires, dans lesquels s'inscrivent selon toute vraisemblance l'expérience et la mémoire de ces habitants. Désir peut-être illusoire, et que la littérature, encore une fois, comble en partie. Ces commentaires constituent une invitation à poursuivre et étendre l'enquête, peut-être dans d'autres villes-mondes.
Erwan Le Méner
e.lemener@samusocial-75.fr