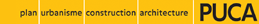JEAN-PIERRE ORFEUIL, FABRICE RIPOLL,
Accès et mobilités, les nouvelles inégalités, Infolio 2015.
Voilà un petit livre précis, au style nerveux et fluide, confrontant le point de vue de deux auteurs très différents, où se mêlent les questions relatives aux ségrégations socio-spatiales, à l’accessibilité, aux mobilités quotidiennes, aux trajectoires résidentielles, à l’aménagement de l’espace conditionnant largement ces phénomènes, mais aussi à la mobilité sociale, aux migrations à grande échelle, aux mouvements contestataires prenant l’espace pour enjeu et à certains conflits internationaux… La notion de mobilité est définie comme l’autonomie du mouvement dans l’espace.
À n’en pas douter, une telle diversité thématique – annoncée dès l’introduction et que les auteurs ont cultivée, non pour brouiller les pistes ou le regard mais pour tracer de nouvelles voies de recherche –, déroutera les partisans de la spécialisation académique et des objets de recherche « pointus » ! Des auteurs aussi sérieux et expérimentés que J.-P. Orfeuil et F. Ripoll savent parfaitement que les facteurs explicatifs des phénomènes dont ils traitent sont presque toujours distincts, mais leur cheminement intellectuel les conduit à jouer le jeu de l’homonymie : à suivre le fil des différents types de déplacements (au sens le plus large de ce terme polysémique) pour mieux rendre compte de leurs soubassements sociaux et, en bout de course, montrer comment ils se trouvent souvent liés. À la limite, le mot mobilité n’est qu’un prétexte pour traiter de ces articulations et ce dans les deux parties qui divisent l’ouvrage, chaque auteur prenant entièrement en charge l’une d’elles.
La première partie, rédigée par Orfeuil, esquisse, tout d’abord et très rapidement, le tableau historique du passage des « sociétés stationnaires » aux sociétés de mobilité : des existences locales avec une destinée fixée à l’avance, jusqu’à la création de l’Institut de la ville en mouvement créé par Peugeot société anonyme (PSA). Accompagnant ce mouvement séculaire, les deux échelles parallèles mesurant les inégalités tant dans les revenus que dans l’espace se rejoignent autour des enjeux de la ségrégation socio-spatiale et des politiques favorisant l’accessibilité à la ville et à l’autonomie. En dépit des performances croissantes de moyens de transport et de télécommunication, s’étonne Orfeuil, l’écrasante majorité des déplacements sont de courte distance tout en étant de moins en moins pédestres. Les grands équipements commerciaux, industriels ou de services, bien que polarisés, sont devenus accessibles pour le plus grand nombre grâce aux véhicules motorisés personnels, en dépit des logiques de ségrégation socio-spatiale qui s’accentuent. Ces derniers sont absolument vitaux pour le tiers de la population française vivant dans des espaces périurbains ou ruraux peu denses, surtout à mesure que les aménités, les emplois et les ressources restent attachés à la ville. Orfeuil souligne avec justesse la vulnérabilité consécutive à l’étalement urbain dans beaucoup de pays développés (surtout aux USA) chez ceux qui ont choisi la propriété d’un logement spacieux au prix de l’éloignement et donc du stress en matière temporelle et d’endettement. De nouvelles pauvretés surgissent ainsi qui s’expliquent par des facteurs où se mêlent le spatial, le social et l’économique.
La seconde partie du livre, plus critique et sociologique, se propose de résister à la mobilité et à ce qu’elle peut receler d’injonctions. Ripoll y relève la faible pertinence des statistiques amalgamant des mobilités hétérogènes ou postulant que les styles de vie librement choisis ont valeur explicative en la matière. Avec une grande (im)pertinence, il pense crucial, également, de ne pas céder au « mobilo-centrisme » dominant dans les milieux de l’aménagement et d’inverser le sens des déterminations trop souvent proposées : la mobilité n’explique pas les classements sociaux mais c’est l’inverse qui s’observe, rigoureusement. Il y est aussi question des logiques politiques à l’œuvre dans ce qui engendre les problèmes d’environnement et les déplacements ou migrations des réfugiés climatiques ou politiques. Si l’espace n’est qu’un milieu où se déroulent des événements disparates, et si les mobilités spatiale (ordinaire ou migratoire), sociale, résidentielle, etc., n’ont pas grand-chose de commun, leurs causes ou leurs conséquences peuvent se rejoindre dans des logiques sociales analogues, voire identiques. Beaucoup de placements, libres ou d’office, entraînent des déplacements contraints. En contrepoint, « il n’existe pas de lieu où l’on trouve de tout », ce qui signifie que les déplacements sont inévitables pour tous, même s’il existe de plus en plus de luttes sociales pour en réduire l’emprise et pour favoriser la proximité.
Une telle démarche lexico-synthétique du livre dans son ensemble pourrait indigner les spécialistes de chacun des champs traversés mais ces derniers seront bien obligés de constater que leur traitement, toujours résumé et nécessairement lacunaire, n’est jamais caricatural. Si les deux parties ne se répondent que peu sur le mode dialogique, elles atteignent toutes deux leur objectif : montrer comment les différents mouvements dans l’espace physique et social se correspondent, au moins partiellement. Cependant, le lecteur pointilleux, bien que séduit par la démarche dans son ensemble – surtout lorsqu’il combat lui-même les morcellements thématiques souvent aveuglants et les œillères de la division du travail scientifique poussant à de trop étroites spécialisations –, pourra relever quelques paradoxes ou s’étonner sur certains points de ce qui est écrit.
En premier lieu, on se demande pourquoi le très grand angle de vue et la perspective historique choisis par les auteurs ne les poussent pas à noter que les sociétés les plus stationnaires quant à leur faible capacité endogène de changement social sont aussi celles qui vivent le plus du mouvement dans l’espace, ce que l’on nomme le nomadisme. L’anthropologie fondamentale enseigne aujourd’hui qu’aucune société n’a jamais été totalement statique et que l’évolutionnisme social qui conduit à cliver ainsi les sociétés froides et les sociétés chaudes se contredit dans son incapacité à expliquer l’avènement des sociétés modernes. On sait aussi que la plupart des grands axes routiers européens étaient des voies romaines elles-mêmes souvent construites sur les chemins déjà institués au paléolithique. L’actuelle fluidité spatiale des équipements de (télé)communication et l’urbanisme fonctionnaliste standardisé ne sauraient contraindre le cadre parisien se passant de voiture – ayant presque tout ce qu’il désire à proximité – ni vaincre le besoin d’interaction et de face à face des personnes ou leur attachement à ce qu’il reste de mémoire des lieux. On s’étonne de l’étonnement d’Orfeuil (sa belle formule dite de « résistance de l’espace ») à ce sujet, sans doute explicable par sa tendance à ne considérer la mobilité que comme attribut et sous l’angle individuel, oubliant ainsi un peu trop que les lieux sont historiquement et symboliquement institués… Certes, il existe des normes de mobilité et des arbitrages personnels en permanence mais pourquoi irait-on systématiquement chercher ailleurs ce qui existe localement, si ce n’est pour céder aux normes de mobilité largement créées par PSA ou Général Motors ? Quelles sont les conditions de déconstruction de « l’impérieuse nécessité de la mobilité au quotidien » qu’Orfeuil relève mais dont il ne désigne pas les acteurs historiques ? La relocalisation de l’économie, alternative à la mondialisation, n’aurait-elle aucune incidence en matière de déplacement de marchandises et d’hommes ?
S’agissant de l’autre versant de l’ouvrage, on ne saurait omettre de relever le paradoxe des appuis répétés sur le paradigme du structuralisme génétique bourdieusien pour traiter de la dialectique de l’action ordinaire et de ses déterminants, alors même que Bourdieu utilisait une métaphore relative aux déplacements pour critiquer les sociologies de l’autonomie prétendant, selon lui, traiter de la libre action comme d’un voyageur de métro qui ne tiendrait pas compte du réseau et des stations… Ripoll pose de salutaires questions telles que « qui produit l’espace et qui produit les usages » ? Mais il n’y répond pas… Pour lui, on ne peut changer la mobilité sans « changer le monde ». Certes ; mais, en matière de déplacements comme d’histoire, le raisonnement actionnaliste en termes de sentiers du quotidien peut néanmoins se révéler fructueux.
En refermant l’ouvrage – des plus stimulants et qu’il faut lire sans le moindre doute –, le lecteur pourra se demander ce que sont les sentiers des mobilités. Ces sentiers ne sont pas uniquement produits selon les intérêts des grandes firmes des pays puissants, puis librement empruntés par des individus plus ou moins dotés économiquement. Comme l’écrivait, avec un raisonnement profond et dialectique où les dynamiques de l’espace et de l’histoire se font par l’action, le poète espagnol Antonio Machado :
Marcheur, il n’existe pas de chemin,
Tout passe et tout reste,
Mais la condition humaine est de passer,
Passer en faisant des chemins (…).
Marcheur, il n’existe pas de chemin,
le chemin se fait en marchant.1
Salvador JUAN, Professeur de sociologie à l’université de Caen, Basse-Normandie.
1. Le texte originel en espagnol est : “Caminante no hay camino, Todo pasa y todo queda, Pero lo nuestro es pasar, Pasar haciendo caminos, (…) Caminante no hay camino, se hace camino al andar…”