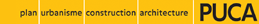Sommaire
numéro 93
mars 2003
Les infortunes de l’espace

Les infortunes de l’espace
« Les riches pleurent aussi » : un feuilleton qui a passionné les téléspectateurs russes et mexicains. A « Dallas », univers de « J.R », les problèmes atteignaient déjà les classes moyennes et leurs multiples sous-fractions. Dans la ville et sur les écrans, l’adversité sociale se lit aujourd’hui comme une ruine, plutôt que comme un conflit ou une exploitation. Les classes n’en finissent plus d’être moyennes, quel que soit le degré de richesse qu’elles affichent. Toutes sont victimes d’une tendance générale à l’appauvrissement dans un monde où la richesse matérielle est de plus en plus corporate, incorporée au capital social des grandes entreprises ou des institutions publiques. Si la fortune a encore figure humaine, les infortunes de ses détenteurs attirent les gazettes : obligation de déménager, nécessité de se protéger, fiscalité incompressible, cotisations sociales éprouvantes… La figure de l’infortune se décline généreusement, et ne s’arrête qu’au bord du dénuement, dans un contexte mondial où une fraction croissante de l’humanité se voit privée des conditions minimales d’urbanité.
Ainsi peut se résumer notre enquête auprès d’un certain nombre de chercheurs étudiant à des titres divers les figures actuelles de la richesse et de la pauvreté dans les villes. Patriciens et plébéiens, hôtel aristocratique et faubourg populeux, beaux quartiers et bidonvilles, la polarisation sociale des récits de l’histoire urbaine s’est faite nostalgie. L’urbanisme moderne a mis à l’ordre du jour l’arasement des inégalités en cherchant à offrir à tous un minimum d’espace, de confort, d’air et d’espoir, hors du paternalisme et de la domesticité. Le droit à la ville a accompagné les aspirations de la société industrielle à l’égalité des conditions urbaines. Aujourd’hui, la récurrence de la question de la mixité sociale dans les politiques de renouvellement urbain atteste du maintien, voire de l’intensification de la ségrégation et des difficultés à mettre en œuvre ces idéaux. Les manifestations et les causes en sont multiples. L’affectation d’une part plus importante du produit de la richesse à l’investissement oblige les consommateurs finaux à financer davantage les services collectifs, à consacrer une part plus importante de leur revenu à leur logement. Les transferts sociaux délibérés dans le cadre du logement social, ou involontaires dans le cas de la loi de 1948, s’amenuisent ou se déplacent vers d’autres âges de la vie. Les salariés sont encouragés à une plus forte mobilité professionnelle et quotidienne qui n’est pas sans conséquence sur les ressources nécessaires à consacrer à la simple vie individuelle ou familiale. Et ce à tous les niveaux de l’échelle sociale. Mais les revenus différenciés des uns et des autres tendent à les disperser selon les lignes de valeurs foncières, dans des configurations locales vécues comme de plus en plus closes.
Les débats entre chercheurs témoignent d’une certaine incertitude : à ceux qui voient la polarisation sociale s’accentuer dans les grandes villes, d’autres répondent qu’au contraire la gestion municipale selon les principes de l’Etat-providence a su maintenir une mixité que la lecture polarisante sous-estime. Il reste que dans un contexte de ralentissement des flux de mobilité sociale et de propagation des situations de précarité dans les pays riches, les marqueurs sociaux de l’espace semblent retrouver une part de leur charge discriminante. Au-delà des clichés journalistiques qui mettent les gated communities (villes privées des nouvelles élites) en regard des homeless (sans abri) pour stigmatiser le chaos urbain contemporain, de nouvelles théories sociales remettent en question tant la dialectique matérialiste entre capital et travail expliquant la division sociale de l’espace que la vision de strates et groupes sociaux en interrelation tripolaire (upper, lower, middle classes). Les figures d’une « société en sablier » où l’écart se creuse entre ceux qui possèdent de plus en plus de biens matériels et symboliques et ceux qui s’en trouvent toujours plus démunis semblent trouver un écho urbain dans la notion de global cities où la mondialisation accélérée des économies se traduirait par un double processus conjoint d’embourgeoisement (gentrification ) et de paupérisation. L’érosion politique de la classe ouvrière accompagnerait cette nouvelle bipolarisation sociale. Dans les nations réunissant de longue date plusieurs cultures, la variable communautaire constituerait l’analyseur principal de la ségrégation urbaine. Profil ethnique, monoparentalité, chômage et économie parallèle produiraient l’underclass dont la concentration dans certains quartiers-ghettos ferait écho à la « sécession urbaine » voulue par les « classes moyennes ». L’observation comparative des situations urbaines dans les pays industrialisés montre que la bipolarisation sociale est recouverte par d’autres processus qui résultent de la croissance des catégories intermédiaires des services. La fuite des grands ensembles populaires par les enfants d’ouvriers devenus employés et les flux d’accession sociale vers les périphéries rurbaines constituent sans doute en France un phénomène aussi important que la gentrification des centres et la paupérisation des cités dégradées.
L’espace, les valeurs immobilières et symboliques qu’il met en scène, ne sont jamais neutres dans ces processus multiples de fragmentation sociale. Le choix de l’Union européenne pour un modèle de ville polycentrique invite à qualifier la pluralité des espaces socio-économiques repérables. Si la proximité spatiale ne va pas sans exacerber parfois les tensions sociales comme la recherche urbaine l’a maintes fois démontré, la distance spatiale n’aggrave pas toujours les processus sécessionnistes latents quand s’affirment de nouveaux cadres, sinon d’intégration, du moins de rassemblement et de débat public. De même que le marché du travail et ses compléments en termes de formation et d’équipements collectifs peuvent être des facteurs importants de partage et d’héritage des richesses, de même a-t-on voulu explorer dans ce numéro les effets de la différenciation de l’espace, de sa qualification comme de sa dévalorisation, dans les mécanismes d’exclusion et d’agrégation. Reposer la question de la coexistence et des trajectoires sociales et économiques à partir d’exemples qui fassent saisir la diversité des histoires qui se jouent dans la ville, et donc les marges d’action qui s’offrent à l’action publique. Le redéploiement des richesses ne s’accompagne sans doute pas tant d’un affaiblissement des liens sociaux que d’une recomposition. Les articles rassemblés ici nous mènent loin de la ville industrielle et du conflit de classe, mais nous confrontent fortement à la diversité des inégalités dans l’accès à l’espace et dans la capacité à le consommer.
Bruxelles a comme toute les grandes villes ses quartiers de richesse et ses îlots de pauvreté. L’ouverture économique au monde y produit nombre de ruptures sociales que la complexité des structures de gouvernance et d’aide sociale rend cependant opaques et diffuses dans l’espace urbain. Les tensions entre générations, groupes ethnicisés et trajectoires individuelles ne produisent pas moins des identités sociales mobiles (Bernard Francq, Xavier Leloup). A Lisbonne comme à Istanbul les opérations d’urbanisme de prestige réalisées depuis une décennie révèlent les profondeurs des antagonismes sociaux dans la ville. Immeubles de standing et barres délabrées se répartissent de part et d’autre du nouveau Parc des Nations de Lisbonne. La rénovation touristique de la Muraille d’Istanbul à grand renfort de crédits internationaux bouleverse son occupation par les populations les plus pauvres de la ville (Christophe Demazière, Frank Dorso). La restructuration des friches industrielles a sensiblement modifié l’espace des villes européennes. Issy-les-Moulineaux et North Lanarkshire sont des banlieues qui ont perdu leur substance industrielle depuis près d’un demi-siècle et qui ont diversement retrouvé depuis peu de nouvelles activités orientées vers l’économie tertiaire et les nouvelles technologies. Entreprises internationales et institutions locales sont les moteurs de ce nouveau cours qui revalorise une partie des territoires au détriment d’autres (Sylvie Fol, Emmanuèle Sabot). A côté des investissements immobiliers haut de gamme et socialement très sélectifs qui qualifient les capitales, chaque ville ne donne pas moins lieu à des opérations moins standardisées qui revalorisent les configurations urbaines (Simon Guy, John Henneberry). Ces nouveaux développements urbains rendent peut-être plus visible le maintien et l’extension à proximité de zones de pauvreté.
Les analyses statistiques de la pauvreté se font à l’échelle nationale et parfois régionale, pour apprécier les besoins ou les effets des aides publiques ; le critère de revenu domine, remis récemment en question par Amartya Sen (prix Nobel d’économie, 1999). L’ajout de critères culturels aux éléments matériels de définition de la pauvreté accroît la difficulté de sa quantification. Le niveau de pauvreté s’avère moins sensible aux variations du marché de l’emploi qu’à celles du développement économique régional du fait des transferts sociaux dont bénéficient des retraités à la recherche de localisations attrayantes. Plus l’échelle d’observation s’affine, plus s’affirme le lien entre pauvreté et pression sur le marché du logement (Emre Korsu), mais moins aussi les modèles économiques agrégés s’avèrent pertinents (Manfred Max Bergman).
Dans un pays riche comme la France, les jeunes sans qualification, les individus sans logement, les immigrés non-communautaires sont les figures montantes de la nouvelle pauvreté. Cités dégradées, quartiers abandonnés des friches industrielles, bourgs ruraux désertifiés forment les images convenues de la précarité (Hervé Vieillard-Baron). Les déplacements urbains des individus sans logement dévoilent une certaine hétérogénéité des situations et des parcours. A Marseille, des liens se dessinent cependant en creux entre les usages précaires du port, du centre et des quartiers périphériques. Les territoires de circulations erratiques entre espaces transitoires et institutions de secours révèlent les ressources résiduelles de la ville (Gilles Suzanne, Marine Vassort). Plus généralement, la globalisation économique et culturelle des sociétés produit ses populations violentées et déplacées aux limites de la survie. Les conflits ethniques, les répressions violentes des conflits sociaux, poussés au paroxysme, conduisent à l’extension de camps de réfugiés dénués des conditions élémentaires de l’urbanité. Dans ces situations de dénuement extrême, et d’inventivité sociale ténue, de résistance, le droit à la vie, suspendu à l’action humanitaire internationale, s’affirme comme le sens premier du droit à la ville (Michel Agier, Thierry Paulais).
En Chine, les migrants qui affluent en masse des campagnes vers les villes représentent aujourd’hui 15% de la population active. A Shangaï, cet exode accroît les disparités de conditions urbaines, notamment au sein même des populations déplacées, mais suscite aussi des relations inédites entre économie organisée et travail informel (Laurence Roulleau-Berger, Shi Lu). En Russie, les inégalités de ressources se sont brusquement aggravées depuis la fin de l’ère soviétique. La propriété d’un logement de qualité est devenu en quelques années un indice majeur de richesse. Le maintien des occupants dans leurs logements « privatisés » a freiné le changement pour l’instant et contrecarré la tendance à l’éviction des ménages à faibles revenus. (Lydia Prokofieva, Vladimir Grichanov, Irina Kortchagina).
La connaissance des classes riches reste cependant le parent pauvre d’une recherche urbaine grandie à l’ombre des politiques sociales. Comme le montrent Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, les classes aisées marquent les villes tout en pratiquant le retrait et la séparation. Elles n’ont eu de cesse de préserver leurs lieux de séjour, de rencontre et de loisir de toute atteinte par les classes dominées, au prix d’investissements non négligeables.
L’autogestion de la richesse reste limitée à des enclaves et ne peut être érigée en modèle. En Argentine depuis deux décennies, la libéralisation économique s’est soldée par un chômage massif à des niveaux de plus en plus élevés de l’échelle sociale. La vague récente de privatisations imposée par les organismes financiers internationaux, évince de la société salariale même les couches moyennes des villes. La banqueroute générale fait éclore de nouveaux mouvements sociaux urbains alliant revendications globales et solidarité locale (Susana Penalva). Tel n’est pas le cas à Londres, où les nouvelles classes moyennes urbaines, mieux loties, se réapproprient les quartiers anciennement populaires sans prendre vraiment part au destin d’une agglomération marquée par un fort accroissement de la pauvreté. Les structures éducatives pour les enfants, l’offre artistique et les relations de bon voisinage sont les facteurs déterminants du choix du lieu de vie au centre de la métropole (Tim Butler). Observations corroborées en France où le classement social dépend principalement de la réussite scolaire. Au souci du bon niveau s’ajoute celui du climat de l’établissement et de l’épanouissement des élèves. La différence des situations n’a d’égal que l’ambivalence des opinions. L’écart entre la norme officielle de mixité scolaire et les pratiques locales ségrégatives n’en est que plus grand (Agnès Van Zanten). En Amérique des quartiers sécurisés protègent les classes moyennes contre les nouvelles classes dangereuses, trop colorées ou trop pauvres. Loin d’atténuer la peur du vol ou de l’agression, la vie dans ces quartiers semble au contraire l’entretenir au quotidien (Setha Low). Chaque citadin se voit renvoyé au choix d’un logement toujours vulnérable dans une société sur laquelle il reste sans prise. Les tentatives d’organisation communautaire des quartiers pauvres par les sociétés philanthropiques issues des quartiers riches au début du siècle, évoquées dans Goldcoast and the Slum (1929), célèbre enquête du sociologue Harvey W. Zorbaugh, sont bien loin. Théoriciens de la « désorganisation sociale », les sociologues de l’Ecole de Chicago avaient d’ailleurs dès l’origine élargi la perspective réformatrice à l’ensemble urbain dans la diversité de ses dynamiques (Christian Topalov).
Les programmes européens de « politiques de la ville » reformulent ces perspectives réformatrices dans le contexte post-industriel et post-Etat-providence. Depuis plus d’une décennie, les instances de coopération européenne se sont en effet saisies de la question de l’exclusion sociale en s’efforçant de fédérer les divers points de vue nationaux, tantôt plus centrés sur la pauvreté économique, tantôt plus attentifs aux processus de marginalisation culturelle. La connaissance des phénomènes et leur traitement politique a reconnu dans la ville une échelle pertinente (Rob Atkinson). En France les grands ensembles d’habitation focalisent aujourd’hui les représentations de la pauvreté analysée en tant que cumul de handicaps sociaux, alors qu’ils étaient les fleurons des politiques sociales des années 1960. L’inflexion du regard s’explique par la volonté politique d’éviter le regroupement de l’immigration étrangère et d’élargir par le haut la sociologie de la ville (Sylvie Tissot).
La ville se fait donc espace distendu et fragmenté, à parcourir de bas en haut autant que possible, à des rythmes variables et avec des buts distincts, suivant les ressources et la position de départ (Vincent Renard). La variété des situations acquises ou héritées est aggravée et étirée par les accrocs de trajectoires liés aux crises économiques. Le mot d’ordre de mixité sociale ne semble que constater cette diversité, et chercher, comme souvent dans les pratiques administratives, à transformer la moyenne en norme morale, inatteignable puisque le jeu social consiste précisément à s’en écarter. En créant une nouvelle échelle d’appréciation des positions au sein de la ville, le mot d’ordre de mixité encourage en effet les citadins qui en ont les moyens à s’orienter vers le bon côté, à rechercher pour eux-mêmes et leurs enfants les marqueurs et les moteurs de la réussite sociale. Stigmatiser le mauvais côté peut être la forme économique, bon marché, d’une telle orientation.