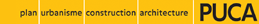Sommaire
La ville standardisée

Editorial
À l’origine de ce numéro des Annales de la recherche urbaine se trouve un constat fréquemment rencontré dans les discours sur l’urbanisme ces dernières années : celui d’une standardisation des espaces publics ou des quartiers, impression si prononcée qu’il semble parfois difficile de les différencier. Ce bruit de fond chuchote que les mêmes « solutions » seraient mises en œuvre, qu’il s’agisse de la reconversion de friches industrielles en espaces culturels, de la transformation des berges en lieux conviviaux, du recours aux mêmes matériaux et formes architecturales dans les écoquartiers, de l’implantation de grands équipements publics manifestes, et seraient ainsi progressivement devenues des « figures imposées » de l’aménagement urbain. Au-delà de cette standardisation des formes urbaines, on observe également de grandes similitudes dans les processus de production urbaine qui s’inscrivent dans un contexte largement documenté de néo-libéralisation des politiques urbaines semblant avoir pour effet une « réduction de l’espace des choix1 » : mise en compétition des villes, montée en puissance des acteurs privés dans la fabrique urbaine, insertion (et exclusion) des mêmes catégories d’acteurs impliquées dans les sphères décisionnaires, politiques urbaines tournées essentiellement vers des objectifs de croissance économique et démographique.
Ce dossier des Annales de la recherche urbaine vise à examiner la véracité de ce récit dominant ainsi schématiquement résumé : les villes se ressemblent de plus en plus pour des raisons liées en partie au contexte de globalisation et au tournant néolibéral des politiques urbaines imposant, ici et là, les mêmes principes et objectifs favorisés par la circulation d’experts internationaux. Assiste-t-on dans ce cadre à un retour de modèles urba-nistiques2 ? Quels en sont leurs caractéristiques et leurs effets concrets ? Ce questionnement, qui n’est certes pas nouveau dans le champ de la recherche urbaine, fait son retour dans les débats entre professionnels et chercheurs3. Les travaux de recherche se multiplient mais restent, pour la plupart, généralement limités à un des aspects du « problème » : la standardisation des processus de production urbaine (avec la montée des partenariats publics-privés, la puissance des normes techniques ou celle des labels), la circulation des modèles urbains (via leur diffusion dans des cercles professionnels ou dans des textes collectifs participant à la production de références) ou les formes urbaines résultant de cette standardisation (villes ou opérations mais aussi secteurs émergents prenant valeur de modèles en particulier). Dans l’appel à articles, nous invitions justement les auteurs à répondre suivant ces trois axes. Premier enseignement : cette partition, si elle est commode pour l’analyse, ne résiste pas à l’examen des cas concrets. Il est bien difficile de désenchevêtrer les modalités de standardisation ou, pour être plus précis, de tirer des enseignements généraux sur les canaux et les effets de la circulation des modèles urbains, tant les situations sont diversifiées. Le recours aux mêmes consultants internationaux ne produit pas nécessairement les mêmes projets urbains et, à l’inverse, des espaces a priori à l’écart des grands flux de la globalisation ou à l’abri des principaux mots d’ordre de la production urbaine n’échappent pas à des formes d’homogénéisation. En la matière, les configurations politiques, sociales et spatiales sont déterminantes dans les conditions d’appropriation des modèles urbains internationaux.
Ce dossier – en convoquant une grande variété de cas et d’objets urbains – permet de déconstruire un certain nombre d’idées reçues. Sans ambition d’exhaustivité, nous pouvons dégager, au moins à titre provisoire, cinq enseignements transversaux des différentes contributions de ce numéro.
La standardisation urbaine restreinte à certains objets dans certains contextes
Gilles Novarina et Stéphane Sadoux soulignent, en introduction de leur analyse des cités-jardins, que la notion de « modèle urbain » renvoie à l’idée d’un original, ou d’un prototype, « débouchant à l’édiction de normes techniques et de règles juridiques qui peuvent être appliquées quels que soient les contextes territoriaux dans lesquels s’insèrent les projets d’aménagement ou de construction ». Pris dans cette acception, rares sont les modèles urbains se transposant terme à terme. En effet, si l’on entend par standardisation la reproduction à l’identique d’une forme architecturale ou urbaine dans des contextes territoriaux différents, force est alors de constater que le phénomène est rare. Il se limite à quelques objets urbains totémiques ou à des contextes sociopolitiques récepteurs spécifiques.
Dans le premier registre, José Chaboche, en s’intéressant aux « grands stades » français, révèle une circulation, linéaire et exceptionnelle par sa « pureté », d’un modèle architecturalo-urbain. Le grand stade est un « lieu-totem » dans la ville, conçu, construit et exploité par quelques firmes du BTP et des services urbains. Il fait en premier lieu l’objet d’une standardisation procédurale : le recours aux partenariats publics-privés est désormais devenu la norme. José Chaboche démontre clairement la manière dont cette standardisation procédurale – le recours au PPP – renouvelle la nature des programmes ainsi que les formes architecturales engendrées. Un stade n’étant généralement pas suffisant à lui seul pour inciter des acteurs privés à s’investir à long terme, ceux-ci assurent la rentabilité de l’ensemble de l’opération en cumulant la diversification et la montée en gamme des services in situ ou aux abords avec un programme immobilier d’accompagnement aboutissant à la formation de véritables morceaux de villes. À cette standardisation programmatique, héritée d’une standardisation procédurale, correspond une standardisation des formes architec-turales et urbaines. Mêmes instruments procéduraux, mêmes programmes, mêmes formes architecturales : le grand stade contemporain semble ainsi incarner la ville standardisée.
Pierre Gras fournit un autre exemple de « totem urbain » n’échappant pas à cette logique de standardisation : l’aménagement des espaces portuaires globalisés. Dès les années 1980-1990, à l’image de l’opération-phare des Docklands à Londres, confiée au secteur privé, les métropoles portuaires entrent dans un nouveau cycle marqué par la volonté de sortir de la crise. Pour se renouveler et « exister » dans la compétition internationale, le levier de l’architecture (et des « grands » architectes) est mobilisé et l’on observe des figures imposées de l’aménagement : waterfont ludique, plateformes de conteneurs… Ces espaces sont mis en conformité avec les standards internationaux sécuritaires et fonctionnels, aboutissant à de fortes similitudes. Pierre Gras montre ainsi que le processus de globalisation affecte particulièrement les métropoles portuaires.
Outre ces deux objets métropolitains – symboles de la globalisation4 –, on observe une standardisation des formes urbaines liée à des contextes sociaux et politiques spécifiques. C’est ce que montre Keira Bachar en s’intéressant aux grands ensembles algériens. Elle observe la multiplication, depuis le milieu des années 1970, de ces quartiers mobilisant l’usage d’un système de construction préfabriqué, constitué de panneaux montés en usine et assemblés sur chantier, permettant la construction de plusieurs milliers de logements en un temps record. La forme urbaine est reproduite d’un quartier à un autre en Algérie, sans modification significative. Seule l’échelle architecturale constitue un support à de petites variations : la volumétrie varie par l’introduction de bâtiments d’angle ou l’ajout d’éléments architectoniques divers. Mais cette variation est surtout esthétique : « Le traitement des façades, de style arabo-mauresque ou arabo-musulman, se limite à reproduire quelques éléments de l’architecture musulmane (arcades, arcs, coupoles, tuiles vertes…), qui sont plus proches de l’“arabisance” que de l’esprit de l’architecture et de l’urbanisme traditionnels. » Keira Bachar dépasse ce constat d’homogénéisation des formes urbaines et dévoile les vecteurs de cette standardisation. Ils sont tous liés au contexte sociopolitique algérien : très forte pression démographique (population algérienne multipliée par 6 entre 1966 et 2008) ; centralisation des décisions et des financements (les dossiers techniques locaux sont établis conformément aux prescriptions techniques et fonctionnelles standards du ministère de l’Habitat ) ; recours aux entreprises internationales (grands ensembles livrés « clé en main », construits avec l’aide d’entreprises étrangères, notamment chinoises) ; savoir-faire traditionnels en voie de disparition. Ce contexte spécifique explique cette forme de standardisation urbaine.
Une lecture dépendant de la distance et de la focale d’observation ?
À la lecture des différentes contributions de ce numéro, il semble que l’impression de standardisation décrite plus haut est aussi et peut-être d’abord une question « de distance de vue », autrement dit « de lunettes ». Ce qui apparait standard au premier regard masque sou-vent une diversité de formes urbaines qui se révèle par une observation plus fine de la matérialité des espaces. Cette diversification mineure traduit des formes d’adaptation des modèles aux contextes locaux.
Mêmes pour des espaces portuaires très homogènes, Pierre Gras reconnait que le fait que cette standardisation aboutisse « à des formes urbaines strictement analogues à l’échelle de la planète est discutable ». Les auteurs de ce numéro rejoignent ce constat et évoquent des processus d’adaptation, d’acclimatation, de négociation qui mènent à des altérations des modèles urbains transposés.
À l’appui de cette thèse, nous pouvons évoquer l’ana-lyse de Louis Baldasseroni des démarches de piétonisation des rues, figure s’il en est de la « ville standardisée » dans l’imaginaire collectif. Le potentiel uniformisant de cette transformation des centres-villes, appliquée et débat-tue depuis plus de 60 ans, mérite d’être interrogée. Si les paysages de ces secteurs piétonniers présentent des similitudes importantes, l’étude comparative de quatre rues lyonnaises piétonnisées entre 1976 et 1978 permet de déconstruire cette impression de standardisation. La diversité des territoires et des initiatives locales produit des paysages différents pour chaque rue, voire d’une portion de rue à une autre, les mobilisations très locales expliquant les différences dans les processus de transformation. En effet, à la diversité d’objectifs assignés aux opérations de piétonisation (rectifier la circulation et le stationnement, améliorer la qualité de vie, favoriser le commerce…) correspondent des mobilisations distinctes : comités de commerçants ou de riverains s’affirment ainsi face à une municipalité et participent à la conception des aménagements, aboutissant à des traductions spatiales présentant des petites variations. Ces différences morphologiques s’expliquent par le type de rue piétonne recherchée, qui renvoie à des imaginaires de centralité variés.
Autre exemple à l’appui de la thèse de l’adaptation locale des modèles urbains, celui des cités-jardins. La cité-jardin constitue un « modèle complet », pour reprendre le terme de Gilles Novarina et Stéphane Sadoux. Il a été diffusé en Europe, aux États-Unis ou en Amérique du Sud et suscite depuis quelques années un regain d’intérêt, notamment en Angleterre. La référence explicite de nombreux projets, qui court jusqu’à certains éco-quartiers français, est la cité-jardin d’Ebenezer Howard.
Les auteurs, via un périple dans un siècle d’histoire de l’urbanisme des villes britanniques et nord-américaines, montrent que le modèle du théoricien de l’urbanisme constitue en pratique « un réservoir diversifié de références, dans lequel les acteurs de l’aménagement urbain puisent pour élaborer des projets parfois différents ». Le modèle de la cité-jardin apparaît à la lecture doté d’une grande plasticité, faisant l’objet de réinterprétations au fil des déplacements, qui interroge au-delà sur sa place dans l’histoire de l’urbanisme.
Le cas des « nouveaux quartiers de gare » qui se sont multipliés au tournant des années 2010 constitue un autre exemple de ce processus d’adaptation du modèle au contexte local. Comme le souligne Aurélie Delage, ces projets renouvelant les quartiers de gare traditionnels hérités du XIXe siècle, à l’image fortement dégradée, pour les transformer en quartiers à vocation d’activité tertiaire autour d’une gare TGV, reposent sur des traits récurrents : « programmation mixte bureaux-logements, rhétorique de l’attractivité territoriale grâce à la connectivité, architecture contemporaine, coproduction publique-privée de la ville dans le cadre du projet urbain ». L’auteur observe « une relative homogénéité des jeux d’acteurs, une homogénéisation de leurs pratiques et in fine des formes urbaines produites ». Pour autant, un premier indice vient interroger la circulation linéaire du modèle : il n’y aurait pas de diffusion du « modèle de quartier de gare TGV » des plus grandes vers les plus petites villes. Si la stratégie mimétique est assumée dans un objectif de marketing territorial, elle n’est pas pour autant appliquée aveuglément. Aurélie Delage montre en effet que « la réalité du marché local constitue une puissante force pour se détacher d’un modèle qui pouvait sembler hors d’échelle ». Il s’opère ainsi, dans « l’atterrissage du modèle », un réajustement du programme. In fine, l’auteure affirme que le standard présente avant tout un « caractère assurantiel » : il ras-sure en proposant un type de projet éprouvé dans d’autres contextes. Si cela favorise l’action collective, surtout dans les villes en difficulté, c’est en raison de la concordance des acteurs que le « projet standard » induit plus que par la garantie d’un type de quartier qui « fonctionnerait » comme accélérateur de métropolisation ou vecteur de dynamisme urbain.
Hélène Nessi se demande si la transition énergétique participe à la production de modèles et si elle induit des effets de standardisation de la production urbaine. Pour répondre à cela, elle analyse deux master plans de transition énergétique. Elle montre que le réseau énergétique décentralisé constitue un modèle de transition énergétique qui s’appuie sur une idéologie techniciste. Les politiques de transition énergétique sont ainsi généralement réduites à proposer des actions dans le domaine de l’énergie et de l’isolation des bâtiments et des outils techniques (panneaux photovoltaïques, éoliennes, hydrogène, voiture électrique, etc.) dont la reproduction est aisée. La transformation de la ville ne passe plus forcé-ment par la transformation spatiale mais par l’adjonction de dispositifs techniques. Dans deux contextes bien distincts, tant par leur localisation géographique que par leur histoire, la région Nord-Pas-de-Calais et la ville de Rome, le même discours et les mêmes solutions technologiques sont proposées. L’auteure constate pourtant que l’application du modèle décentralisé aboutit à un échec à Rome et à des effets positifs en Nord-Pas-de-Calais. Ces différences locales s’expliquent par l’implication des acteurs locaux dans le travail d’appropriation de ces modèles afin qu’ils ne soient pas la simple transposition de solutions techniques mais deviennent des projets de territoire. Ces acteurs dis-posent ainsi de marges de manœuvre dans l’adaptation des modèles internationaux, fussent-ils promus par un expert international comme Jeremy Rifkin.
Des formes discrètes mais déterminantes de standardisation
Plusieurs contributions mettent en avant l’existence de « formes discrètes de standardisation » qui s’avèrent probablement plus déterminantes que les plus emblématiques décrites ci-dessus. Nous pouvons en citer trois.
En analysant la production résidentielle ordinaire, c’est-à-dire diffuse, Florence Laumière, Mariette Sibertin-Blanc et Corinne Siino analysent un « urbanisme au fil de l’eau ». La métropole toulousaine est un terrain particulièrement pertinent pour analyser les effets de ce type de production urbaine (identifiable par la recherche d’opportunités foncières en vue d’opérations à forte rentabilité soutenues par les politiques de défiscalisation), car elle s’inscrit dans un contexte de faible stratégie urbaine dans les décennies 1980 et 1990. Largement majoritaire (80 % de la production de logements), émanant des promoteurs ou des bailleurs sociaux, cette production d’une offre résidentielle qui s’immisce partout dans la ville s’avère banale, suivant une logique de rentabilité des produits défiscalisés. « Sans grande originalité, assez standardisées dans leurs formes architecturales, ces constructions de trois à six étages, souvent sous forme de résidences fermées, intégrant parfois des résidences-hôtels, verdies a minima, recomposent le paysage toulousain. » Les auteures s’interrogent sur cette forme de standardisation et ses effets sur l’urbanité. Ce mode de production – sans stratégie publique d’aménagement affirmée – permet certes de construire des logements, mais dans un environnement immédiat qui fait l’objet d’un traitement peu qualitatif – en témoignent la faible qualité des espaces publics et le déficit d’équipements publics. Cette fabrique urbaine ordinaire fragilise l’urbanité, au moins autant que la réplication de bâtiments emblématiques également standardisés.
Dans le même registre, à distance des grandes opérations urbanistiques, Claire Fonticelli et Patrick Moquay s’intéressent à la densification des centres-bourgs franci-liens. Ces opérations menées dans des espaces périurbains recourent à des formes urbaines et architecturales communes, quel que soit le nombre de logements créés ou leur implantation. Ces architectures sont souvent qualifiées du préfixe néo suivi du qualificatif de l’architecture locale : « néo-vexinoise », « néo-briarde »… Elles imitent les constructions traditionnelles des villages par des renvois à l’architecture vernaculaire locale (matériaux, ornements). Le résultat de cette « injonction à densifier, liée à la diffusion d’un modèle de ville dense vue comme durable, se traduit par la généralisation de modèles d’urbanisme et d’architecture reposant sur de nouveaux stéréotypes ». Outre la standardisation elle-même, cette densification « à tout prix » peut en outre aller à l’encontre de la qualité patrimoniale des bourgs. On densifie en utilisant d’anciennes dents creuses ou des fonds de jardins, alors que ces vides font largement le charme des centres-bourgs. Les auteurs nous montrent des constructions de qualité médiocre, sans souci des espaces publics ou du cadre paysager préexistant.
Enfin, autre forme de standardisation, nichée cette fois-ci dans les plis de l’innovation : celle révélée par Nicolas Monnot et Monica Berri du collectif Common. Langage à propos de l’urbanisme transitoire. Faisant le constat d’une multiplication des actions de réappropriation des espaces vacants, ces démarches qualifiées d’expérimentales, souvent portées par de jeunes collectifs d’architectes et d’urbanistes revendiquant une pratique « alternative » de la conception urbaine, seraient en réa-lité elles-mêmes « en voie de standardisation », de par leurs formes urbaines et leurs effets produits sur les territoires dans lesquels elles sont pratiquées. Les auteurs parlent ainsi d’un « référent urbain alternatif » mobilisant une esthétique de l’événementiel culturel.
Le marché de la standardisation
Tout laisse à croire qu’il existe des gagnants et des perdants de cette homogénéisation des espaces urbains et de leur fabrique, qui se présente aussi comme un grand marché. Parmi les premiers, figurent les consultants et les experts de la production urbaine. Nicolas Bataille et Guillaume Lacroix se penchent sur le cas intellectuelles à destination des collectivités locales, de leurs regroupements et des aménageurs. Les deux doctorants, « embarqués chez des ingénieristes » via le dispositif Cifre, montrent comment ces acteurs participent à la circulation de modèles, de bonnes pratiques et de référentiels qui conduisent à standardiser les méthodes de conception urbaine. Ils révèlent que ce sont d’abord les mécanismes réglant la relation de marché commanditaire-prestataire qui incitent à standardiser les méthodes. La mise en concurrence via la commande publique serait le principal vecteur de cette standardisation. En effet, celle-ci met en œuvre des « dispositifs de jugement » qui visent à apporter une garantie sur le choix du prestataire. Rassurer le client est un objectif central, a fortiori dans un contexte économique dégradé. Par un jeu incontournable des « références » qui constituent un catalogue de solutions, le mécanisme concurrentiel de la sous-traitance de l’ingénierie participe de cette standardisation.
Hélène Nessi, quant à elle, s’intéresse au cas emblématique de l’économiste et consultant international Jeremy Rifkin. Son discours sur la « troisième révolution indus-trielle » propose un modèle énergétique et des solutions techniques identiques, qu’il « vend » à travers le monde. D’autres contributeurs du numéro mettent l’accent sur le rôle central des consultants internationaux, ces « experts voyageurs » pour reprendre l’expression de Marco Chitti, experts à succès autant que contestés qui se partagent le marché comme le font les « starchitectes ».
Si le contexte de globalisation et la standardisation associée produit un marché lucratif pour un milieu d’experts et de consultants, on compte aussi des « perdants » dans ce processus de diffusion des modèles urbains internationaux.
Marta Pappalardo, en s’intéressant à la patrimonialisation des centres-villes, révèle ainsi un processus qui standardise non seulement les formes urbaines, mais également un certain modèle de « société responsable dans lequel la protection du patrimoine urbain serait gage d’un savoir-vivre nécessaire pour habiter les centres ». En se patrimonialisant, les centres-villes voient de nouvelles fonctions et de nouvelles pratiques s’affirmer et deviennent les lieux privilégiés de la consommation culturelle et du tourisme « responsable ». La « redécouverte » des centres, avec la patrimonialisation comme stratégie de développement, conduit à un changement social. En prenant comme cas d’étude le centre-ville de Naples, classé « patrimoine de l’humanité » par l’Unesco, l’auteure démontre que les politiques patrimoniales menées depuis 2009 aboutissent à l’imposition d’une norme sociale délégitimant les classes populaires, au profit de couches supérieures et d’un tiers acteur : le touriste. Elle spécifique des « ingénieristes » qui élaborent des prestations évoque ainsi une « patrimonialisation par le haut ». Sans même parler de leur éviction par le phénomène large-ment documenté de gentrification, les classes populaires sont accusées à Naples de ne pas respecter et sauvegarder le patrimoine, et ainsi de faire baisser la réputation de la ville. L’appropriation microlocale de l’espace limitrophe au logement constitue l’une des formes les plus visibles de cette pratique populaire de l’espace, qui se déploie de l’habitat aux pratiques de voisinage, formant cette « économie de la ruelle » typiquement napolitaine. Ces usages sont menacés par le processus de patrimonialisation.
Dans un registre différent, Giulio Lupo et Barbara Badiani s’intéressent à ce qui apparaît comme un modèle urbanistique, au sens d’une forme urbaine souhaitable, aux yeux d’une partie des classes moyennes et des élus qui les représentent : l’urbanisme post-moderne du New Urbanism. Récompensés par des jurys internationaux, s’inspirant de la « ville d’autrefois » dont ils décortiquent certains éléments formels pour les réadapter à leur façon, les urbanistes du Plessis-Robinson proposent une standardisation désirable. Jouant avec un autre modèle puisqu’il se glisse sous l’appellation de « cité-jardin », la métamorphose du Plessis-Robinson se révèle pourtant après analyse ne pas être « l’application des théories urbanistiques du nouvel urbanisme. Elle est davantage le résultat d’un dis-positif constitué d’éléments hétérogènes qui considèrent la ville comme une marchandise ». Au final, c’est le marketing qui primerait selon les auteurs : dans l’œil du viseur, ce serait moins la forme urbaine que la clientèle susceptible de connaître le succès immobilier et finale-ment de redistribuer les cartes du peuplement communal.
Les limites d’une lecture post-coloniale
Le dernier enseignement du numéro que nous souhaitions souligner porte sur l’analyse internationale du processus de standardisation urbaine. Plusieurs auteurs soulignent que la lecture postcoloniale suivant laquelle des modèles urbains issus des pays du Nord s’imposent à des pays du Sud peine à rendre compte de la complexité des processus.
C’est en particulier le cas de Marco Chitti, qui s’intéresse à l’assistance technique en tant que filière privilégiée de circulation Nord-Sud d’expertise en urbanisme. Selon lui, l’approche postcoloniale traduit un regard trop éloigné pour rendre compte des processus de transfert des modèles urbains. Cette vision fondée sur les rapports de force économiques ne serait plus adaptée au contexte contemporain multipolaire : les flux se multiplient et de nouveaux pays « émetteurs » de modèles urbains s’imposent en dehors du contexte occidental, et des trajectoires Sud-Sud émergent tout comme des réseaux alternatifs de circulation.
David Navarrete Escobedo estime quant à lui que l’étude du contexte local des pays récepteurs permet de dépasser la première impression d’une forte standardisation pour révéler des processus différenciés, hétérogènes « d’acclimatation » des modèles urbains contemporains. Les raisons en sont multiples : les architectes « stars » sont bien souvent obligés de s’associer avec des architectes locaux ; la standardisation des villes latino-américaines qu’il étudie concerne uniquement certains territoires, ceux qui possèdent la plus grande valeur symbolique ou économique et qui sont les mieux connectés aux réseaux de la mondialisation. Il souligne le paradoxe suivant : « L’influence des pays centraux avec une grande tradition théorique urbaine n’implique pas mécaniquement une standardisation des formes spatiales et des modèles urbains, mais plutôt une acclimatation des modèles spatiaux et une déconstruction critique des modèles idéologiques urbains du “premier monde”, les référents étrangers pouvant devenir des outils théoriques latino-américains. »
À partir d’études monographiques, Divya Leducq et Félix Lefebvre arrivent à la même conclusion. La stratégie urbaine de Hanoï se construit sous l’injonction au développement durable autour d’un urbanisme de croissance visant à asseoir la place de cette ville non occidentale dans la compétition des grandes métropoles mondiales. L’étude du Master Plan de Hanoï menée par Divya Leducq au prisme des opérations urbaines en cours de réalisation permet de rendre compte de l’effet conjugué des modèles et de leur promotion par les bailleurs de fonds internationaux sur la production d’une ville. Premier enseignement : à Hanoï, l’emprunt à des modèles inter-nationaux d’urbanisation n’est pas récent (influence de la Chine sur la ville féodale, de la France sur la ville coloniale…). Par ailleurs, le catalogue des bonnes pratiques internationales est fondé sur un référencement explicite de master plans jugés exemplaires, déjà mis en œuvre ou en cours d’exécution. Les scènes d’échange variées entre des consultants internationaux conduisent à « une homogénéisation partielle et relative des modèles sur le terrain ». En effet, l’auteure estime que la production urbaine reste un compromis issu de la rencontre entre la vision des acteurs locaux avec les propositions des consultants internationaux. « Le cas de Hanoi montre qu’il existe une tension permanente entre des solutions clés en main et des déclinaisons par apprentissage. »
Le cas de Ouagadougou, « capitale périphérique » du marché mondial des villes, est analysé par Félix Lefebvre, qui démontre que la succession de modèles s’est toujours heurtée à la réalité du terrain et a fait l’objet de renégociations permanentes. L’auteur analyse les deux grandes logiques des modèles urbains internationaux : la logique pro-growth de performance économique par la mise en marché et la libéralisation dans la lignée des plans d’ajustement structurels (« faire rentrer les périphéries du monde dans la compétition mondiale »), et la logique pro-poor de performance politique et sociale par l’inclusion des populations défavorisées et le renforcement des capacités de celles-ci (ce qui fait partie des exigences des bailleurs de fonds). Dans le cas de Ouagadougou, l’importation d’un modèle urbain n’est pas couronnée de succès, la situation politique, sociale et économique n’étant pas adaptée aux logiques de performance défendues par les bailleurs inter-nationaux. Pour reprendre la conclusion de Marco Chitti, l’urbanisme demeure malgré tout un « exercice situé et circonstanciel ».
Ainsi, ces travaux de recherche nous rendent plus intelligibles le monde social et l’espace urbain, tout en montrant la nécessité de dépasser la lecture que l’on peut avoir en première approche du phénomène de standardisation des villes. En définitive, ils invitent à se rapprocher du fait empirique tant peuvent apparaître parfois « [pares-seuses] les étiquettes (…) de “modèle” et les explications rapides en terme “d’influence5” ». Ils appellent à examiner, dans leurs contextes, les circulations et les accommodements des « fragments globalisés6 » de ces modèles que proposent les marchés (marchés des idées comme ceux des échanges économiques). Nous pouvons alors à la lecture de ce numéro dégager un certain nombre d’enseignements, théoriques et pratiques, qui nous incitent à poursuivre les études sur les transferts de modèles et à réfléchir aux conditions par lesquelles un territoire et ses acteurs « résistent et apprivoisent » les grandes tendances de l’urbanisme contemporain.
Olivier Ratouis, professeur à l’université Paris Nanterre
Bertrand Vallet, rédacteur en chef des Annales de la recherche urbaine
1. Huré M., Rousseau M., Béal V., Gardon S. et Meillerand M.-C.(dir.), (2018), (Re)penser les politiques urbaines. Retour sur vingt
ans d’action publique dans les villes françaises (1995-2015), Plan urbanisme construction architecture (Recherche), 341 p.
2. Claire Carriou et Olivier Ratouis, « Actualité des modèles urbanistiques », Métropolitiques, 18 juin 2014. [en ligne] https://www. metropolitiques.eu/Actualite-des-modeles.html
3. Pour ne citer qu’une référence récente, voir A.Bourdin et J. Idt (dir.), (2016), L’urbanisme des modèles. Références, benchmarking et bonnes pratiques, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube.
4. L’analyse n’est évidemment pas exhaustive et l’on aurait pu imaginer des contributions portant sur d’autres types d’espaces, comme les grands équipements culturels, qui viendraient vraisemblablement confirmer l’hypothèse de standardisation induite par la globalisation.
5. Saunier P.-Y., (2005), « Épilogue : à l’assaut de l’espace transnational de l’urbain, ou la piste des mobilités », Géocarrefour, 80 (3), pp. 249-253.
6. Souami T. et Verdeil É. (dir.), (2006), Concevoir et gérer les villes. Milieux d’urbanistes du Sud de la Méditerranée, Paris, Economica Anthropos, coll. « Villes », 230 p.