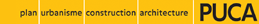Sommaire
Numéro 86 juin 2000
Développements et coopérations

QUELLES COOPÉRATIONS
POUR LE DÉVELOPPEMENT ?
Rassembler des contributions de chercheurs déclinant
la notion de développement urbain depuis
des positions très différentes relève peut-être d’une
nouvelle « religion des mots » (cf. Bernard Kalaora, Ethnologie
française, 1999). Qu’y a-t-il en effet de commun
entre des pratiques d’experts issus des sciences
économiques, géographiques, et parfois sociologiques,
qui s’attachent à évaluer ce qu’il en est de la pauvreté
relative de certains espaces, et à y proposer remède? Les
démarches de connaissance et d’intervention sur les
territoires sont-elles déjà de fait toutes soumises aux
mêmes critères d’appréciation, à une exigence de pertinence
mondialisée qui ne fait plus des terrains que des
points d’application d’un même discours universalisant
? Ce discours est-il scientifique, à la fois descriptif
et explicatif, ou n’est-il que politique, accompagnement
idéologique d’une domination économique ?
Sans doute participons-nous, du fait de la position
institutionnelle de la revue, de l’attitude qui consiste à
« mettre à plat » les termes d’un débat, plutôt qu’à en
pousser l’argumentation à son point de fusion. Pourtant,
en demandant aux uns et aux autres, de façon
relativement aléatoire, mais avec le souci de « couvrir »
le champ, qu’est-ce qu’était pour eux « le développement
économique local urbain », terme proposé à notre
méditation par Catherine Farvacque-Vitkovic (Banque
mondiale), nous avons découvert que le principal
réquisit du développement était la « coopération ». Non
pas au sens administratif du terme, mais au sens
basique : le fait que deux acteurs travaillent ensemble,
deux acteurs ne partageant clairement pas la même
identité, deux acteurs hétérogènes l’un à l’autre. Ce
n’est que dans la relation à une hétérogénéité, dans son
acceptation, dans son exploitation, qu’on peut se développer
: expression simplifiée de la théorie des externalités
positives.
En période de crise, la théorie de « la croissance
endogène » et les pratiques du « développement local »
ont permis de retrouver un certain optimisme. Or la
nouvelle mise en oeuvre du capital humain proposée
s’appuie sur une politique de transferts d’argent
public en direction des institutions de formation et
des universités, et sur la constitution de nouveaux
acteurs sur le terrain.
L’ensemble des cas de figures évoqués ici, dans la
diversité des échelles territoriales considérées, invite
précisément à observer à chaque fois l’émergence de
nouveaux acteurs, et les modalités de l’organisation de
leur coopération, ou les risques qu’il y a à les laisser
opérer hors d’institutions de coordination, hors de la
production de nouveaux types d’espaces publics.
L’intérêt du « développement économique local
urbain », tel qu’il se constitue comme objet de
recherche, et comme enjeu de pratiques, c’est qu’il est
d’emblée public dans son appréciation, sa discussion,
son évaluation, alors que le logement, objet antérieur
et encore actuel des politiques urbaines, est un bien
privé, auquel il est demandé à la puissance publique de
garantir l’accès, dans une action qui dans les pays développés
ne se poursuit qu’à la marge.
Les critiques souligneront que cet élargissement du
débat sur la coopération urbaine masque la segmentation
des formes d’action selon les publics, et les villes
cibles : investissements financiers et industriels dans les
villes susceptibles de rembourser les prêts, coopérations
culturelles et techniques entre les municipalités des
villes de second rang, actions spécifiques en direction
des populations les plus pauvres par l’intermédiaire des
organisations non gouvernementales. Une stratification
au coeur de laquelle les transversalisations seraient
davantage maffieuses et prédatrices, que publiques et
démocratisantes. C’est le point de vue défendu ici par
Annik Osmont. Nous faisons l’hypothèse que c’est la
composition des attitudes de ceux qui oeuvrent au coeur
de ces situations, notamment de ceux qui les commentent,
qui fera la différence, selon le principe de la « prophétie
autoréalisatrice », avancé par Robert K. Merton.
La chose est donc objectivement indécidable mais peut
faire l’objet d’un acte de foi « laïc ».
Quatre formes de développement sont à distinguer
dans le corpus que nous avons rassemblé. Elles correspondent
à des moments historiques successifs dans la
prise de conscience des problèmes posés par la transformation
des villes : vision quantitative du développement
urbain, découverte sociale de l’inégal développement
au sein de la ville, réflexion économique sur les
externalités, premières explorations de la notion de
développement durable.
Le développement urbain
en masse
Comme l’indiquent Catherine Farvacque-Vitkovic
et Lucien Godin, la population urbaine est maintenant
majoritaire sur tous les continents y compris
l’Afrique. Toutes les analyses convergent pour dire que
la fraction du PIB produite dans les villes est supérieure
à la part des villes dans les populations nationales
: elles sont donc plus productives. Le débat porte
maintenant sur la part respective des régions capitales
et des régions centrées autour de villes secondaires.
Huhua Cao, Ying Zhao et Sylvain Losier abordent la
question de la métropole régionale avec le cas de la
région urbaine de Shanghaï, qui avec le concours des
investissements étrangers s’est lancée dans des travaux
gigantesques, alors qu’elle accueille déjà 30 % de la
population chinoise et produit 40 % du PIB. Depuis
1990, 5 000 compagnies étrangères venant de 70 pays
se sont installées dans l’île de Pudong qui se hérisse de
tours. Il reste, avec l’aide du gouvernement central qui
accompagne toute l’opération, à développer les services
aux entreprises et à la population qui ne sont pas aux
standards internationaux, et à traiter du problème de la
population flottante d’origine rurale qui n’a pas les qualifications
nécessaires pour participer à cette croissance.
Au Maroc, le développement urbain se heurte à la
faible disponibilité en terrains équipés d’après Mohamed
Benlahcen Tlemçani et Rufin Missamou. Cependant,
depuis 1987, les opérations de relogement ont permis
de former des opérateurs publics à des modes de gestion
innovants. Les entrepreneurs en bâtiment doivent articuler
les exigences des deux sociétés de référence,
moderne, et traditionnelle ; un travail de composition
qui en fait des agents de coopération sociale d’autant
plus essentiels que les moyens publics sont largement en
deçà des besoins estimés.
A Cotonou au Bénin, la pression foncière quantitative
est moins forte qu’il y a quelques années, mais la
spéculation foncière bat son plein. Les trois quarts des
habitants n’ont pas de terrain en pleine propriété ; les
plus fortunés d’entre eux cherchent à s’en procurer.
Les mutations se succèdent à vive allure, mais les terrains
acquis ne sont construits qu’à 10 %. Régularisations
par l’État, accueil de réfugiés d’autres pays, tout
concourt à augmenter les prix. 90 % de l’activité du
pays est concentrée à Cotonou, et l’argent disponible
pour ce jeu augmente. Il faudrait restructurer le marché
immobilier. Les dépendances économiques et
intellectuelles le permettront-elles ?
Le développement social urbain
Si le terme de « développement social urbain »,
inventé par des habitants et repris par les institutions
avant d’être transformé en « politique de la ville », n’a pas de traduction mot à mot dans les autres langues, les
pratiques de rénovation, de réhabilitation, de régénération
et aujourd’hui de « renouvellement urbain » se
sont développées dans tous les pays à commencer par
les États-Unis. Marie-Hélène Bacqué propose un bilan
de ces trente-cinq années de luttes contre la dualisation
sociale, de coopération directe entre le gouvernement
central et les associations d’habitants des quartiers défavorisés.
À la lumière de ces expériences, cette coopération
ne doit-elle pas être vue plutôt comme un passage
de relais, un désengagement, une ouverture incapable
de compenser le recul global sur les transferts sociaux ?
À Anvers, Christophe Demazière observe que malgré
les initiatives sociales en direction des vieux quartiers
ouvriers, le déclin économique de ceux-ci ne peut
être enrayé, même si des moyens sont mis à la disposition
des habitants par des associations aidées par l’État
pour créer des entreprises et se former. La complémentarité
entre ces nouvelles micro-entreprises et le développement
en cours dans la métropole existe dans le
secteur de la maintenance urbaine, mais cela revient à
spécialiser la population de ces quartiers dans des travaux
très dévalorisés. Comment développer de nouveaux
partenariats avec des acteurs de la métropole
pour cette population, lorsque l’action publique vise
surtout à soutenir le revenu individuel ?
Marie-France Prévôt Schapira rencontre le même
type de problème en Argentine où les contraintes politiques
internationales limitant les dépenses publiques
ont transformé les politiques sociales en plans d’assistance
ciblée et personnalisée, pendant que se multiplient
les organismes de médiation entre l’État et les pauvres.
Le nombre de ceux-ci va croissant du fait de l’évolution
du marché du travail : emploi informel, mises à la
retraite, chômage. Et du coup, les budgets des plans
d’assistance ne sont pas suffisants. La sélection des bons
pauvres reconstitue les clientèles politiques qui devaient
disparaître avec l’abolition de la politique sociale corporatiste.
Les solidarités de proximité ne constituent
qu’une « citoyenneté à basse intensité », assignée à résidence
dans la commune de distribution des fonds.
Le développement local urbain
Pourtant, si l’on considère l’économie du point de
vue de la population et de l’emploi plutôt qu’en termes
de valeur ajoutée, ce sont ces solidarités de proximité,
ces relations de voisinage qui constituent les ressources
les plus sûres pour un développement de l’emploi local.
Les services à la population, privés et publics, constituent
dans un pays comme la France l’essentiel de l’emploi
local, nous dit Laurent Davezies. Si la voie de développement
qui consiste à attirer des investissements
semblent bouchée, on peut toujours par une politique
de gestion du paysage, par la création d’établissements
de formation, attirer des retraités, ou des étudiants, des gens « non-actifs » et dont les revenus, issus de transferts
à l’échelle nationale, engendrent de l’emploi local.
Michel de Bernardy décline l’hypothèse dans le cas
du développement par la recherche et l’expérimentation
de nouvelles technologies. Il en appelle au développement
d’apprentissages collectifs régionaux pour favoriser
l’innovation et le renouvellement des compétences.
Dans ce modèle de croissance, l’État, et éventuellement
les institutions internationales comme l’Union Européenne,
occupent une place de choix comme garants de
cette nouvelle éclosion d’entreprises locales essaimant à
partir de l’Université. Jean-Marie Cour, en présentant le
programme Ecoloc pour l’Afrique de l’Ouest, montre
cette stratégie à l’oeuvre dans des petites régions urbanocentrées
où les experts ont pour rôle de faire émerger des
coalitions d’intérêts autour de la formation et de l’information
économiques.
Xavier Greffe choisit un autre type d’externalité présente
dans le territoire et mobilisable pour le développement
: le patrimoine historique, qu’une gestion prudente
a su préserver et qui va maintenant pouvoir se
transmettre tout en devenant un levier de croissance
économique, via la fréquentation touristique. Certes,
cela ne va pas sans contradictions car il n’est pas sûr
que le patrimoine valorisé pour les touristes soit celui
qui intéresse le plus les habitants. Des conflits de droits
de propriété peuvent être provoqués par des opérations
de réhabilitation du patrimoine construit. Comme
toute dimension de développement local, la gestion
du patrimoine est objet de choix politiques qui doivent
être débattus publiquement.
Le développement durable
des villes
Sur ce nouvel avatar de l’urbanisme, le débat est loin
d’être clos, tant la durabilité n’est supportable que comprise
au deuxième, troisième, voire nième degré. Et tant
la pression économique pour satisfaire la demande d’urbanisation
la plus rustique continue de s’exercer lourdement
comme le montre Jean Louis Zentelin.
Nombre de chercheurs préfèrent se rabattre alors sur
la dimension plus sûre des luttes contre les pollutions,
tout en essayant d’en faire des enjeux de bonne gouvernance
locale, de coordination entre entreprises, et entre
les entreprises et les partenaires publics. Tel est le cas de
Vincent Roche, Natacha Gondran, Valérie Laforest et
Christian Brodhag constatant que si la territorialisation
d’une problématique est un critère d’efficacité, elle
rebute les experts internationaux à la recherche de références
universalisables. Ils soulignent par ailleurs la réticence
des partenaires locaux à la réglementation et l’apparition
dans ce champ d’experts autrement efficaces,
les agents financiers et d’assurances.
Mais quel va être le coût pour les usagers finaux,
notamment des pays du Tiers monde, de technologies dans lesquelles auront été incorporées les exigences
mondiales de respect de l’environnement se demandent
Jean-Claude Bolay, Yves Pedrazzini et Adriana Rabinovich?
Certes, les organisations internationales s’efforcent
d’élaborer des critères universels d’évaluation du
développement durable, mais ceux-ci ne vont-ils pas
avoir pour effet de classer une fois de plus sur une
échelle qui fera toujours apparaître les mêmes exclus ?
Ne doit-on pas s’attendre à une augmentation générale
des dépenses inhérentes à la vie urbaine, encore davantage
génératrice d’habitat précaire sous-équipé ? Sans
péréquation des coûts, le développement durable ne
risque-t-il pas de conforter son contraire ?
Marc Gossé avance l’hypothèse qu’en faisant fi des
formes construites par l’histoire, le développementalisme
économique participe toujours d’une entreprise
de désappropriation des populations de leur territoire
qui ne peut que se traduire par une anti-productivité
généralisée. Hypothèse séduisante qui conduit à une
conception du développement durable comme maintien
et construction d’une biodiversité naturelle et culturelle.
Dominique Lorrain, plus prudent, se demande
comment construire une coopération avec des partenaires
qui à l’instar des Chinois tiennent des documents
comptables modulables au gré des circonstances
et multiplient en miroir les structures de dialogues.
Une expérience redoutable mais qui l’invite tout même
à croire en la pérennité des possibilités de commerce
avec la bureaucratie céleste recyclée dans le management
des grandes compagnies privatisées.
Le développement
des régions urbaines
Cet ensemble de recherches fait de la grande région
urbaine, organisée autour d’une métropole capable de
dégager et d’organiser la redistribution d’un surplus, le
véritable sujet politique et géographique du développement
tant urbain qu’économique. Une conclusion à
laquelle sont parvenus de leur côté les chercheurs
réunis à l’Université de Californie à Los Angeles du
21 au 23 Octobre 1999. La vision est unifiée au niveau
mondial, soumise dans ses réalisations à l’infinie diversité
de l’échelle locale, et capable de s’accommoder de
n’importe quel régime politique, soit toutes les qualités
du « concept » international. Georges Cavallier, qui
coordonnait la délégation française au Sommet des
villes à Istanbul en 1996, estime important de ne pas
en rester à cette indifférence aux conditions institutionnelles
de réalisation des programmes et des projets
: le travail de coopération ne va pas sans reconnaître
les inégalités et mettre en oeuvre les péréquations
indispensables à la crédibilité du développement.
Anne Querrien, Pierre Lassave