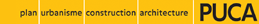Sommaire
numéro 102 octobre 2007
Individualisme et production de l’urbain

L’individualisme peut être défini soit comme un ensemble de représentations et de pratiques sociales qui caractérisent et affectent la vie urbaine, soit comme un ensemble de valeurs liées à la démocratie libérale.
Aujourd’hui on observe une tension culturelle et idéologique forte entre, d’une part, une tendance générale dans le monde occidental qui associe démocratisation et individualisme, qui lie espoir d’émancipation, revendication d’autonomie, reconnaissance de la responsabilité et de la capacité d’expertise des individus et d’autre part, un modèle de solidarité et de justice sociale qui perçoit dans la montée de l’individualisme un ferment de désagrégation sociale et une attaque contre le projet d’égalité.
Parallèlement, la vie dans les métropoles occidentales accompagne le processus d’individuation auquel sont soumis les urbains. Les individus sont selon la formule de Marcel Gauchet « désenglobés » c’est-à-dire que l’appartenance à des collectifs identificateurs est devenue moins prégnante et plus éphémère. De fait, la désynchronisation des rythmes de vie et de travail, la modification des structures familiales et la multiplication des ménages composés d’une seule personne par exemple constituent des facteurs qui infléchissent les attentes en matière de services urbains aussi bien que les programmes immobiliers. De même, l’économie post-industrielle fondée principalement sur l’information et la communication, corrélée au mode de vie métropolitain, impose un système culturel où règne la pluralité des références, la relativité des valeurs, ce qui accentue l’impératif démocratique. Ce dernier, comme l’avait énoncé Tocqueville, nécessite que chacun construise de manière individuelle son identité et son rapport aux autres et au monde.
Dans la sociologie contemporaine le débat est ouvert entre ceux qui diagnostiquent l’hypermodernité urbaine comme le foyer de l’individualisme solipsiste et consumériste, voire de la généralisation de la solitude, et ceux qui perçoivent le monde contemporain comme le règne d’un individualisme tempéré par la multiplication des activités relationnelles et associatives et par le remplacement de liens forts mais peu nombreux par des liens plus ténus mais foisonnants. Pour ces derniers, l’individualisme est plus émancipation que déréliction.
Par ailleurs les principes politiques qui nous gouvernent sont assis sur la liberté individuelle (refus du communautarisme) et entrent en tension avec les idéaux de solidarité et de cohésion sociales, si bien que les politiques publiques oscillent entre la valorisation d’un côté du libre arbitre de l’individu et de l’autorégulation de la société (logiques de marché, démocratie participative, partenariat,…) et de l’autre la valorisation de « l’être ensemble », du « faire société » dont une politique d’équipements publics et de mixité sociale serait garante.
Dans la tradition politique française, l’urbain dense a constitué une forme sociale et culturelle valorisée, symbole de cohésion sociale et d’ordre public légitime. De sorte que la forme collective de la communauté regroupée autour de ses institutions (incarnées par l’hôtel de ville, le quartier historique… au centre de la cité) est censée doter d’une figure matérielle et visible l’idéal politique de l’unité sociale. C’est sans doute la raison pour laquelle est régulièrement dénoncée la figure inverse, celle de l’individu activant sa rationalité propre pour choisir la localisation de son logement ou de son activité quand cela aboutit soit à l’étalement urbain, soit au regroupement affinitaire, contrevenant alors à la mixité sociale.
Dans l’idéologie actuelle la ville se substitue à la nation comme terrain privilégié d’exercice de la démocratie et l’urbanité devient un corollaire de la citoyenneté. Le discours des politiques urbaines actuelles est articulé autour des notions de « vivre ensemble » et de « faire société ». Or, nombre de propos politiques et urbanistiques affirment que les agglomérations avec leurs banlieues, leurs centres commerciaux périphériques et leurs zones d’habitat pavillonnaires mettent à mal les vertus d’urbanité dont serait porteuse la ville centre. Dans ces discours le périurbain est lié à une montée de l’égoïsme et à l’exacerbation de l’individualisme de masse qui caractérise la fin du XXe siècle. La critique des espaces à faible densité fait même partie des motifs exposés dans la loi Solidarité et renouvellement urbains dont l’idée sous-jacente est de favoriser une ville plus dense que devraient promouvoir les nouveaux outils de planification (SCOT).
Habiter hors la ville est pourtant considéré par de nombreux chercheurs comme la condition commune et souvent obligée d’un nombre croissant de nos concitoyens, comme l’a montré le programme de recherches du PUCA sur la mobilité urbaine. Ce n’est d’ailleurs pas toujours synonyme d’égoïsme, les périurbains étant les premiers à se mobiliser pour accueillir les réfugiés en cas de besoin, comme lors de la crise du Kosovo, étudiée par Anne Gotman, dans son livre sur Le sens de l’hospitalité.
La virulence avec laquelle les urbanistes condamnent l’idéal pavillonnaire, qu’ils contribuent pourtant à mettre en œuvre sur le terrain, nous a incitées à aller y voir de plus près, et à interroger directement le postulat d’une corrélation étroite entre croissance de l’individualisme et périurbanisation.
Pour Éric Charmes c’est la fragmentation communale française qui donne à la périurbanisation son caractère chaotique et inorganisé, anti-urbain. Mais sans fragmentation communale ne connaît-on pas également un développement de la ville diffuse, en Italie notamment où Bruno Secchi a inventé cette expression ?
Philippe Genestier souligne d’ailleurs que l’opposition idéologique des aménageurs publics à la dispersion urbaine au motif que l’égoïsme des périurbains empêcherait de faire passer près de chez eux de précieuses infrastructures, accompagne en fait le développement sur le terrain de ces infrastructures. Il s’agit en fait de réaffirmer la prééminence de l’ordre public sur les logiques sociales, au moment où on cède toujours plus davantage devant elles. En s’inspirant de François Ascher on pourrait dire : ces événements nous dépassent, feignons d’en être les anti-organisateurs.
Le péri-urbain lui-même est mis en péril par la montée de l’individualisme, estime Rodolphe Dodier. Il est souvent à la croisée des chemins, entre développement de nouvelles formes de citoyenneté dans les lieux de croissance économique, et évolution possible vers le repli en cas de déclin. Des signes des deux types d’évolution sont déjà perceptibles.
Le quartier qui fait référence pour construire la citoyenneté locale dans la ville dense ne fait plus recette dans le péri-urbain, où les agrégats sont ou trop restreints – le lotissement, le village – ou trop distendus, comme dans la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau, observée systématiquement par Yves Chalas. La vie se déroule dans la maison ou au sein de toute l’aire urbaine, selon des modalités nouvelles marquées par la mobilité automobile. François Mancebo estime en revanche que ces espaces peu denses seront entièrement urbanisés, pour répondre aux exigences d’un développement durable. Dans cette densification à venir il faudra savoir préserver les cheminements créés par les habitants, à la différence de ce qui s’est fait quand on a installé les grands ensembles dans les banlieues.
Les trajectoires de vie des habitants, plus encore que les cheminements sur le terrain, sont déterminantes dans les usages différenciés faits de ce mode d’habitat, souligne Yannick Sencébé ; comme Rodolphe Dodier elle constate que le repli sécuritaire des uns, le retour au pays, voisine avec l’ouverture à de nouvelles relations, et avec le dynamisme de nouveaux habitants. La différence est moins financière que d’orientation, comme l’avaient déjà montré en 1970 Jean-Claude Chamberodon et Madeleine Lemaire pour les grands ensembles.
L’habitat pavillonnaire, caractérisé tout de même par l’entre-soi et les relations sociales de proximité, peut-il être considéré comme potentiellement enclavé, peut-il devenir fermé. ? C’est la question que se pose Céline Loudier-Malgouyres dans le cas de la région parisienne. Elle découvre des tracés de lotissements déjà très en rupture avec leur environnement, notamment du fait du nombre limité des entrées. Elle juge qu’il s’agit d’« espaces défendables » au sens d’Oscar Newman, dans lesquels la sécurité est censée être assurée par la co-veillance communautaire plus que par la police républicaine. Ces lotissements n’ont plus qu’une barrière à mettre à l’entrée pour devenir des communautés fermées. Cette évolution est-elle vraisemblable ?
Vues depuis l’Amérique latine par Guénola Capron, Monica Larrieu et Maria Florencia Girola, ces communautés fermées ne sont pas si désirables que cela, notamment pour les femmes au foyer qui s’y ennuient. Le sentiment de solitude et d’enfermement peut prévaloir sur celui de sécurité.
Le problème en France n’est d’ailleurs plus tant celui des lotissements que du diffus, hors agglomération, dans la nature. Jean-Charles Castel examine les facteurs économiques de cet émiettement de l’urbain, et se demande si le coût pour la collectivité d’un mode de vie urbain pour tous (égalité de desserte par les services publics) demeure supportable dans ces conditions.
La principale valeur du centre jusqu’ici, sa richesse en emplois plus encore qu’en services, s’effrite d’ailleurs avec les nouvelles localisations des entreprises dans le péri-urbain, qui ne concernent plus seulement « l’économie résidentielle », ajoutent Ludovic Chalonge et Francis Beaucire. La périphérie urbaine devient un espace de travail, autant que de vie, notamment pour les internautes, observés par Paulette Duarte. À la ville comme dans le périurbain, les individus développent des nouvelles solidarités, pour se loger notamment. Les personnes âgées peuvent accueillir gratuitement des étudiants par exemple, selon des modalités différenciées étudiées par Sophie Némoz.
L’aptitude à la solidarité ne semble pas réservée à la ville centre. Elle inspire de nombreuses pratiques des périphéries, qui ne peuvent être stigmatisées au motif de leur égoïsme foncier, estiment Fabrice Ripoll et Jean Rivière. Les géographes, qui condamnent politiquement le péri-urbain au nom de sa propension à voter pour les extrêmes, limitent leurs analyses aux circonstances conformes à leurs analyses, les lisières des plus grandes villes. Dans l’ouest le rejet de l’autre marque plutôt les sites de désindustrialisation. Les explications ne peuvent donc être aussi unilatérales. À quoi Jacques Lévy leur répond que les faits cartographiques sont têtus, et doivent être considérés. De grandes agglomérations politiquement démocratiques sont nécessaires pour intégrer ces tendances à la fuite et au repli.
L’analyse de l’imagerie pavillonnaire dans les films et la publicité vient clore ce dossier. Avec Anne Bossé, Laurent Devisme et Marc Dumont on revient dans le pavillon et à ses abords, dans une société stéréotypée et sérialisée. Le semblable centré sur soi y est déployable à l’infini, modèle imaginaire qui conditionne les pratiques et les représentations des chercheurs comme des aménageurs. Dans cet univers, comme dans les communautés fermées d’Amérique Latine, l’événement est forcément dérangeant et effrayant pour ceux qu’ils concernent. Le spectateur est invité à juger ce quotidien dérisoire ou à s’y identifier, à critiquer ou à acheter. On retrouve là encore le dualisme constaté à propos de cet univers apparemment homogène par la plupart des auteurs de ce numéro.
Habiter un pavillon ou regarder la vie pavillonnaire depuis une autre forme d’habitat ne mobilise pas les mêmes analyses et les mêmes pratiques. Nicole Haumont et ses collègues l’avaient déjà souligné dans Les pavillonnaires en 1966. Mais l’univers pavillonnaire d’aujourd’hui a perdu la façade unanimiste de cette époque. Il n’a plus rien de neuf, même s’il est toujours le cadre de la construction neuve. Il est traversé de tensions économiques et sociales qui dépendent de décisions prises à un autre niveau. Les pratiques d’entraide solidarité que permet un habitat spacieux ne sauraient se substituer à l’éventail de services publics et privés développés par la vie urbaine. La diffusion du périurbain au-delà des frontières des agglomérations urbaines, l’urban sprawl que constatent tous les pays européens, quelles que soient leurs structures communales, implique de reconsidérer les rapports ville-campagne tels qu’ils sont décrits depuis les débuts de l’industrialisation. La désindustrialisation a créé une condition urbaine nouvelle, comme le dit Olivier Mongin, dont l’étude en est encore à ses balbutiements.