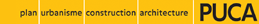Sommaire
Numéro 83 84 Septembre 1999
Au risque des espaces publics

« Au risque des espaces publics » : les aménageurs
se trouvent confrontés depuis quelques années à la
demande de limiter, de segmenter, de privatiser les
espaces communs, au nom de la sécurité. Dans tous
les pays, et pas seulement aux États-Unis, on signale
des pratiques de « sécession » 1, de fermeture des lotissements
et des espaces autrefois accessibles au public.
L'espace des rues se spécialise et signale visuellement
ses parties réservées à tel ou tel type d'usage. La fête
foraine elle-même, déplacée voire menacée, se trouve
submergée par les représentations collectives de l'insécurité
que feraient régner alentour certaines personnes
qu'elle attire. La nouvelle appétence de la
société pour la violence2 se serait même manifestée
lors de la Fête de la Musique, le 21 juin 1999 à Paris,
avec la réception par les urgences des hôpitaux d'une
centaine de personnes agressées, quand la police avait
recensé moins d'une vingtaine de plaintes. L'augmentation
de la délinquance de voie publique, et
surtout des « incivilités », est attestée par tous les
observateurs, sociologues, politistes et experts de la
police3. Leurs analyses obligent la recherche urbaine
à s'interroger sur l'un de ses concepts-clés : qu'en est-il
de l'espace public forgé dans les grandes métropoles
au début du siècle, lorsque la ville ouverte à
l'étranger construisait un rapport pacificateur entre
citadins ou passants, ainsi que Georg Simmel a pu le
montrer ?
Le concept d'espace public a toujours posé problème,
parce qu'il s'est développé selon trois acceptions
: d'abord simple lieu urbain commun, remis au
goût du jour par le courant écologiste en tant que
territoire des interactions sociales ; puis avec Jürgen
Habermas4, espace délibératif, formé de pairs, en
charge d'établir une opinion commune, de définir
un plan d'action collective ; enfin avec Isaac Joseph,
un espace de co-présence entre individus réunis par
la fréquentation d'une « ville sans qualités » 5, dans le
respect mutuel et quasi muet qu'implique le seul fait
de faire société. Cependant dans tous les cas une
puissance invitante a constitué l'espace comme
public, en organisant le cadre matériel de la rencontre
et la régulation des échanges en son sein. Cet
espace-là n'a pas de participants externes à l'image
qu'il donne et se donne de lui-même, sinon ce
maître de cérémonie dont il ne connaît que des
représentants, État ou collectivité publique, à qui
chacun rend hommage par le respect des règles.
Cette condition fondamentale de l'absence d'extériorité
semble aujourd'hui rongée, attaquée à la
marge, dans une urbanisation contemporaine aux
prises avec des figures de l'exclusion multiples qui
définissent par recoupement des personnes ou des
lieux menaçants. On ne connaît de l'insécurité que
les victimes, guère les auteurs. Le travail public
consiste alors à tenter de diminuer les risques encourus,
en faisant prendre des précautions personnelles,
et surtout en modifiant l'espace physique, pour renforcer
l'impression sinon la réalité de la sécurité.
Cette démarche rapproche la lutte contre l'insécurité
de la prévention des risques naturels : il s'agit de
dire aux citadins que le pouvoir veille.
Pour les risques sociétaux comme pour les risques
naturels, la tendance est à leur « gestion » en incitant
à la constitution de scènes locales de débat
autour des mesures de prévention6. La répression
elle-même est incorporée dans la prévention des
conduites « insécures ». Ces scènes locales sont formées
en priorité avec des agents des diverses administrations
publiques, et parfois en consultant des
associations d'habitants. Elles ne forment que de
quasi espaces publics puisqu'elles n'englobent pas
ceux avec qui la communication a été rompue. Le
principal facteur de risque reste donc externe, comme dans le traitement de la catastrophe naturelle.
Les acteurs de ces instances n'ayant pas la totalité
de l'espace social comme référence, constituent
une scène experte, mais ne peuvent réellement fabriquer
de plans d'action co-produits au sens strict ; les
plans sont en fait donnés à chaque institution séparément,
au risque de renforcer les tendances à l'éclatement.
La dispersion des activités et de l'habitat
dans l'espace urbain fait alors des services scolaires,
de consommation et de circulation, les seuls espaces
de liaison sociale, les seuls lieux où peut être restitué
un semblant de vie collective. Des contre-mesures de
précaution sont demandées par le personnel de ces
services pour la surcharge de tension que leur créent
une situation à laquelle ils ne peuvent échapper sans
quitter leur fonction. À certains l'évitement est
impossible ; là se concentre la hantise de l'agression,
là pèse l'exclusion.
L'ensemble des articles ici rassemblés évoquent
plus ou moins directement ces questions. Au milieu
de l'archipel d'espaces spécialisés, et repliés sur leurs
territoires professionnels ou habitants, quel va pouvoir
être le rôle d'une police de proximité ? Chaque
institution s'est en effet équipée, en attendant, de
moyens technologiques ou humains spécifiques, rendant
la tâche de coordination de la police, une fois
réformée, encore plus malaisée (Frédéric Ocqueteau).
N'y a-t-il pas d'ailleurs une certaine contradiction
entre la mission de constituer un ordre
public national, homogène, garanti par les modes
de recrutement, de formation et de mobilité des
fonctionnaires et celle donnée nouvellement aux
membres du même corps d'être des partenaires à
part entière de territoires différenciés (Dominique
Monjardet) ? Sur quelle consistance sociale fonder
ces partenariats locaux quand la grande ville délie les
proximités d'habitat et de travail qui constituaient le
voisinage dans la ville d'Ancien Régime, et permettaient
de trouver des quasi bénévoles pour assurer la
surveillance et la régulation locales (Jean-Luc Laffont)
? Le souci d'avoir une police représentative de
la diversité de la population, y compris de ses minorités
ethniques, ne se heurte-t-il pas aux habitudes
de langage racistes de tout un chacun ? Des habitudes
que l'expérience des commissariats anglais
montre difficiles à supporter dans le travail policier
quotidien (Simon Holdaway).
La réception d'un changement impulsé du centre
sera forcément différente selon les contextes locaux.
Celui de Kourou en Guyane est sans doute extrême,
et fortement marqué par la ségrégation spatiale et
sociale des divers groupes qui ont peuplé le site, et
ont été figés dans des positions différentes par les
politiques publiques. Paradoxalement ce qui fait lien dans cette situation, c'est l'ensemble des institutions
publiques, et ici plus qu'ailleurs. Mais elles n'ont pas
vraiment de prise sur les comportements des habitants
les plus enracinés localement, car leur avenir
est trop incertain, voire certainement bouché
(Elkana Joseph-Affandi).
Pour le jeune déjà là dans la métropole à l'aube
du XXIe siècle, la parole et l'apprentissage social ne
sont plus des plaisirs mais les vecteurs de la soumission
à l'ordre de l'exclusion. L'isolement dans un
« contre-monde », surchargé des icônes du monde
dominant, devient la règle (Didier Lapeyronnie).
Analyse qui risque de conduire, quoiqu'en dise l'auteur,
à la conclusion de l'impossibilité d'une réintégration
dans l'univers politique commun. Eric
Macé, moins pessimiste, conclut plutôt à une action
de harcèlement en mal de reconnaissance, qui pourrait
être accueillie au plan politique car elle exprime
le décalage entre les principes démocratiques qui
animent celui-ci et la réalité urbaine. Cette revendication
pourrait être facteur de changement. A force
de rester sans réponse elle peut devenir facteur de
production d'étrangeté brute, et mettre à mal la proposition.
C'est à cette extériorité sociale en combat direct
avec l'armée, plus encore qu'avec la police, pour le
contrôle de certains territoires urbains, que pense
Luis Machado da Silva, quand il analyse l'augmentation
de la criminalité violente au Brésil ces dernières
années. La violence y est un mode de
conquête des biens et des services nécessaire au
développement d'une économie parallèle mondialisée
et d'une contre-société qui ne croit plus aux vertus
économiques de la démocratisation politique.
Le rapport des délinquants au territoire est alors
purement instrumental et imparable, il n'a plus de
caractère de classe ; l'argent se prend là où il est
d'accès facile, dans les favelas le cas échéant. Cela ne
facilite pas le travail de protection, et cela donne à
réfléchir sur les risques inhérents aux contremondes
émergents. Le fonctionnement de la justice
au Brésil rend d'ailleurs la population peu
coopérante avec les institutions, tant cet appareil
de justice est marqué par son caractère de classe et
par une conception régalienne de la propriété, qui
la réserve aux dirigeants et exclut encore une bonne
partie de la population des bénéfices des institutions
gouvernementales (Roberto Kant de Lima).
Ce n'est donc pas au Brésil qu'on peut voir se développer
des scènes locales où pourraient se négocier
des mesures de sécurisation de la vie quotidienne.
En Seine-Saint-Denis dans la région parisienne, le
Parquet semble croire qu'on peut convoquer de
telles scènes, commissions ou groupements, et opérer,
main dans la main avec les autres institutions publiques, une remise en ordre du territoire local,
comme si les causes de sa dégradation étaient directement
saisissables. Anne Wyvekens décrit précisément
l'esprit dans lequel sont menées ces opérations
de traitement local de la délinquance. Si les
forces de sécession et de mondialisation sont ici à
l'oeuvre, cette nouvelle animation institutionnelle
n'est-elle pas un leurre7 ? Peut-on créer du territoire
autour de l'habitat dès lors que cet habitat, en gestion
publique, est parlé comme devant être détruit,
est symboliquement dévalorisé ?
Les tentatives d'institution de quasi espaces publics
de débat se multiplient, faisant intervenir bureaux
d'études et équipes de psychosociologues, cet apport
extérieur soulignant d'ailleurs leur caractère temporaire.
Leur action ressemble à celle du médecin supposé
savoir ce qu'il en est de la santé sociale, sans qu'il
soit question d'entreprendre un travail analytique qui
conduirait à la remise en cause de ce postulat, et à des
transformations institutionnelles plus profondes.
Dans l'un des deux cas présentés par Joëlle Bordet et
Jean Dubost, le diagnostic n'a d'ailleurs pas été fait
avec des habitants, absence qui en limite la portée ; le
principal intérêt de telles initiatives, à savoir transmettre
de l'information aux victimes potentielles, et
leur permettre d'ajuster leurs comportements, a été
perdu de vue.
Les familles immigrées et notamment les pères,
sont parmi les principaux exclus de ces lieux de
parole, qui se développent en général aux heures de
travail. Il est alors courant de stigmatiser leur démission
pour expliquer les problèmes rencontrés par
leurs enfants. En allant y voir de plus près, avec la
méthode des récits de vie, Catherine Delcroix nous
montre que les attitudes éducatives des parents se
différencient plutôt selon leurs disponibilités financières
: satisfaction des besoins de consommation
ostentatoire lorsque ces ressources sont limitées,
paiement de loisirs organisés et des moyens de l'insertion
sociale lorsque ces ressources sont plus élevées.
Les jeunes qui ont des difficultés se retrouvent
dans les deux groupes, sans qu'il soit possible d'établir
une corrélation probante avec les attitudes
parentales. Les familles rencontrées par Michaël
Wearing à Sydney semblent encore plus défavorisées,
peut-être à cause de la politique du logement
australienne, peut-être à cause d'une enquête faite en
milieu de journée avec des habitants qui ne travaillent
pas. La recherche montre que les habitants
parlent de leur détresse avec les mêmes mots, les
mêmes images, utilisés par les autres pour parler
d'eux. Leur vie croise l'insécurité, la drogue, la solitude,
la violence, l'absence d'argent. Et le changement
ne semble pouvoir venir que du dehors, comme une catastrophe (naturelle ?) : démolition,
suppression des services sociaux, ou peut-être politique
de réhabilitation pour les Jeux Olympiques.
Avec Mike Brogden et l'Afrique du Sud, le changement
politique est là, l'apartheid n'est plus. Mais la
société demeure, avec ses différences, ses inégalités,
son chômage croissant. La criminalité augmente en
tout cas dans les quartiers blancs qui ne sont plus les
seuls protégés. Plusieurs explications, couramment
données, de cette inefficacité du nouveau régime sont
passées en revue. La seule qui paraisse à la hauteur du
phénomène est le développement de l'économie
parallèle, et les risques pris par ceux qui y participent.
Nassima Dris décrit en revanche les interactions dans
le centre d'Alger où la résistance laïque s'observe à la
diminution de la densité des voiles. Elle note une tendance
à repousser les limites assignées de la bienséance,
mais aussi une vulnérabilité liée au développement
de l'économie parallèle. Vincenzo Ruggiero a
une vision plus positive de l'économie souterraine,
ou du moins de la mutation de l'économie vers le
travail indépendant. Les Centri Sociali qui accueillent
en Italie les jeunes désoeuvrés sont des lieux de vie
occupés dans la foulée du mouvement de contestation
des années 1970. Ils se sont largement dépolitisés et
oeuvrent à transformer la contre-culture en ressource
pour l'accès à l'emploi. L'existence de tels lieux peutelle
expliquer la moindre hostilité apparente des
jeunes à l'ordre institué, l'inexistence d'une revendication
à la fois vide et violente face aux institutions
étatiques ?
À New York, malgré toutes les incitations à l'autoorganisation,
cette revendication existe, lancinante,
dans le cas de Harlem, en direction d'une municipalité
qui laisse le quartier noir dépérir, sous-équipé,
avec peu d'aires de jeu en particulier. Mais à Central
Park on n'aime pas la proximité des jeunes Noirs. Et
la sociologue, habitante de Harlem, de rêver d'un égal
équipement de tous les quartiers (Julia Nevarez). A
Paris, l'universel reste le référent, mais la transformation
du parc de logement social en unités résidentielles
clôturées est à l'ordre du jour (Jade Tabet).
Leurs habitants seraient protégés des intrusions indésirables
et la rue serait éloignée au risque de l'incommodité
quotidienne. Les adolescents plus que jamais
exclus de ces enclos vont mettre quelques temps à
élaborer de nouvelles stratégies pour s'y manifester.
L'évocation du travail de Jane Jacobs et des groupes de
femmes de Toronto par Gerda Wekerlé peut être lue au premier degré comme un plaidoyer pour de telles
mesures de sécurisation, pour une ville où l'espace
commun est en permanence surveillé par les riverains.
Mais il s'agit aussi pour l'auteur de présenter une
manière différente de faire de la recherche, à la
manière de l'advocacy planning : un travail de mise en
forme des paroles des habitants ou des gens de terrain,
appelés ici experts de la vie quotidienne.
Comme le montrent les notes techniques et
réflexions sur l'accident routier en France (Bertrand
Christian), sur l'éruption volcanique à Quito (Pascale
Metzger et alii), sur l'inondation à Nice (Anne
Tricot, Jean Lolive) ou sur la pollution en Finlande (Marja Ylönen), la construction de scènes publiques
locales de gestion des risques se généralise.
Les différends internes que l'observation de ces
instances souligne soutiennent paradoxalement leur
existence. Reste que lorsque les volontés de pacification
sociale se définissent en lieu et place des autres,
dans un contexte urbain qui de surcroît tend à
l'éclatement des référents communs et à la multiplication
des communications ou des malentendus à
distance, l'espace public prend sérieusement des
risques.
Anne Querrien, Pierre Lassave