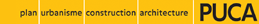Sommaire
Numéro 95
Juin 2004
Apprivoiser les catastrophes

Pourquoi consacrer un numéro aux risques quand
les publications se multiplient sur cette question ?
Jocelyne Dubois Maury et Claude Chaline en particulier
dressent un panorama quasi exhaustif de tous
les risques naturels dont l’espace urbain est menacé,
et des différentes mesures légales prévues pour l’en
préserver. Mais qu’a voulu dire Ulrich Beck en parlant
de « société du risque », et que cherchent à évoquer
ceux qui comme Anthony Giddens en Grande Bretagne
ou Jean-Pierre Dupuy en France lui ont emboîté
le pas ?
De grands corps d’ingénieurs, celui des Ponts et
Chaussées et celui des Mines, ont évité aux Français
depuis le XVIII e siècle de se poser ce genre de question.
Le corps des Ponts et Chaussées s’est constitué
pour entraver tout ce qui nuisait à la circulation des
personnes et des marchandises, en utilisant la main
d’oeuvre au chômage dans les campagnes. D’emblée il
s’est mis en travers des risques d’atteinte à l’ordre
public et c’est ce qui a fait son succès. Quant au corps
des Mines il s’est distingué en calculant des machines
qui diminuaient le risque d’accident tout en améliorant
le rendement.
Dès le Siècle des lumières l’État se constitue
comme gestionnaire d’une « société du risque » où la
prévention des aléas joue un rôle moteur dans l’amélioration
des choses. De travaux en travaux cette amélioration
devient tout à fait réelle. L’évolution de la
norme est éclairante à ce sujet. C’est ainsi que la circulaire
Caquot en 1949 invite à dimensionner les
égouts de façon que la crue centennale soit avalée en
une heure. Les égouts de Paris sont capables de cette
performance.
La construction des villes nouvelles est l’occasion de
découvrir que cette norme, inappliquée par la plupart
des villes de province, est inapplicable financièrement
en ÎledeFrance également. Des solutions fort élégantes
sont trouvées en allant chercher des idées à
l’étranger. Les bassins de rétention sont de retour alors qu’ils avaient été fortement déconseillés. On passe outre et on se résigne à faire les meilleurs équipements possibles avec l’argent dont on dispose.
Le risque a alors été pris de quelques débordements
; ils seraient compensés financièrement. Mais
d’où vient l’idée d’assurer les risques ? Son apparition est attestée fin XVII e dans le commerce maritime : certains bateaux rencontrent des récifs, origine du mot
risque en anglosaxon, et leur cargaison est perdue.
Les armateurs se cotisent alors pour la rembourser
collectivement. Calcul de la cotisation et de l’indemnisation
impliquent de savoir combien de fois la rencontre
du récif intervient par rapport au nombre total
des déplacements. Le risque est un raisonnement
mathématique et financier bien éloigné du sentiment
de l’habitant inondé qui contemple ses affaires à moitié
noyées.
De nos jours, de plus en plus souvent, des habitants
se retrouvent les pieds dans la boue. Les inondations
augmentent, fruit de l’imperméabilisation des
sols et du caractère de plus en plus chaotique des précipitations.
Une exposition à la Cité des sciences présente
des images de Paris transformée en Venise du
XXII e siècle. Le réchauffement de la planète est une certitude
par rapport à laquelle il convient que l’ensemble
des acteurs sociaux s’organisent. C’est ce dont prend
acte le protocole de Kyoto ; c’est ce pourquoi militent
des organisations de plus en plus nombreuses. Les
assurances ont déjà des difficultés à compenser les
catastrophes récentes. Les sociétés de réassurance ont
du mal à trouver de l’argent sur les marchés financiers.
L’État songe à limiter sa largesse dans l’indemnisation
des catastrophes naturelles. Un retour à la
prévention physique des risques se dessine, mais elle
est autrement plus complexe à concevoir qu’il y a trois
siècles, et n’évitera plus la concertation avec les habitants,
prévue d’ailleurs dans les plans locaux d’urbanisme.
De nouvelles attitudes commencent à se diffuser
pour faire face à cette nouvelle situation, attitudes
faites de gestion partagée et de solidarité.
La difficulté vient de ce que la majorité des personnes
perçoivent encore les risques comme des puissances
extérieures et attendent des autorités qu’elles réduisent leur occurrence à zéro, ou qu’à défaut les
assurances compensent la négligence collective. Mais
les riverains soumis à des inondations à répétition se
rendent compte qu’il faut passer à une nouvelle politique,
rassembler un partenariat plus vaste pour agir
(Jacques Lolive).
Patrick PerettiWatel estime aussi que l’heure est à
de nouvelles modalités de gouvernance où toutes les
formes de parole, qualifiées techniquement ou non,
seraient prises en compte.
Or l’intervention publique a cherché jusqu’à présent
à neutraliser le risque par de nombreux dispositifs
tant institutionnels que matériels. Le risque a été
perçu comme la représentation d’un événement d’autant
plus virtuel, voire impossible, qu’une administration
puissante s’employait à en repousser l’éventualité.
Les profanes ont été priés de suivre les consignes
de sécurité sans trop s’intéresser aux dispositifs techniques
qui leur étaient associés. Tant que la catastrophe
ne se manifestait guère, cela convenait. Et cela
a permis de constater que la ville n’est pas un facteur
de risques, au contraire ; une fois la catastrophe arrivée
en revanche, on rencontre en ville plus d’habitants et
surtout des habitants mieux assurés. Le risque urbain
n’est pas naturel, mais socioéconomique. En attendant
la catastrophe les habitants, eux, voient les fissures
dans les murs, les petites taches, et autres signes
de problèmes à venir, et savent que les assurances ne
compenseront pas leurs pertes, notamment la dévalorisation
foncière des biens situés en zone de risque.
L’État navigue au mieux des intérêts contradictoires
des fauteurs de risques et de leurs victimes, aux sorts
bien souvent liés (Thierry Coanus, Emmanuel Martinais,
François Duchêne).
Lorsque ce risque vient d’une usine structurant
toute la vie quotidienne d’une commune, organisant
ses temps de loisirs, distribuant une part importante
de ses revenus, le niveau de contradictions est particulièrement
élevé. Si l’usine ferme ou diminue son
activité, le chômage, la désindustrialisation et la
déstructuration sociale s’ensuivent. Si on interdit de
construire autour de l’usine, la valeur des propriétés
foncières se tasse, un îlot de paupérisation sociale se
crée. La taxe professionnelle unique dans toute l’agglomération
apparaît un cadeau empoisonné : elle
diminue les ressources des communes industrielles,
et sape le modèle ouvrier de vie quotidienne avec ses
nombreux équipements collectifs (Violaine Girard).
Quand la catastrophe est déjà du passé se pose la
question de la mémoire. Les desiderata des parents des
victimes priment, mais ne coïncident pas avec ceux
des habitants de la commune où a eu lieu le drame.
Celleci reste stigmatisée par un événement auquel
elle ne pouvait pas grand’chose lorsque les permis de
construire n’étaient pas du ressort du maire. La responsabilité
morale de ce dernier est exigée par l’ensemble
des acteurs du drame (Gaëlle Clavandier).
Jacques Roux préfère partir de la notion de précaution.
La ville d’aujourd’hui est caractérisée par une
multitude de dangers que font courir les uns aux
autres. Il faut retrouver les vieux réflexes face aux
inondations, c’estàdire le partage des tâches, la solidarité.
La notion de risque a consisté à faire reculer la
catastrophe dans l’indéterminé pour créer un espace
de gestion commun aux techniciens et aux financiers.
Les chercheurs qui ont inventé la notion de principe
de précaution ont voulu faire entrer dans cet espace les
profanes. Les habitants et les membres des services
techniques locaux doivent devenir ensemble producteurs
de la cité, garants de son existence collective, de
son développement durable, de ce que de leur environnement
ils entendent faire demeurer (Jacques
Roux).
L’exemple de Quito au Pérou donné par Alexis
Sierra montre aussi que les représentations des techniciens
ne coïncident pas avec ce qu’observent les
habitants. Les actions de prévention visent les pentes
de la montagne, quand les bouchons dans les réseaux
ont lieu au centre ville. L’aléa sert à justifier le verdissement
des quartiers valorisés et l’interdiction de
construire là où se pressent les pauvres. Comme les
personnes aisées sont les premières à se plaindre en
cas de problème, le souci de répondre à la demande
justifie le déséquilibre de la réponse technique en leur
faveur. Mais les contradictions sociospatiales s’accentuent,
la ville risque de devenir ingouvernable.
Le cas de la plateforme pétrolière dans la baie de
Caxias au Brésil témoigne d’autres contradictions
sociales. La firme nationale brésilienne Petrobrás a de
nombreux certificats ISO mais le matériel n’est pas
partout aux normes. Le syndicat ouvrier n’a guère de
prise sur la question, qu’il mélange d’ailleurs à celle
du caractère public et national de l’entreprise. En
revanche les pêcheurs ont obtenu des compensations
pour la pollution de la baie. L’entreprise forme les
habitants alentour à des mesures de précaution. Elle
jouit d’une hégémonie sur le territoire peu propice à
une gouvernance collective (Henri Acselrad et Cecilia
de Mello).
Au Japon, la fréquence des catastrophes et parfois
leur importance en victimes et en dégâts ont entraîné
un grand mouvement de solidarité : un million de
bénévoles sont venus à Kobé après le tremblement de
terre de 1995. Les municipalités essaient de former la
population aux secours dans les quartiers. Des ateliers
d’exploration de la ville renforcent l’attention aux dispositifs
de secours et apprennent les mesures d’urgence
élémentaires. La collaboration bénévolesscientifiques
se développe (Tomohide Atsumi).
La certitude de la catastrophe, d’ailleurs nécessaire
pour recevoir la prime d’assurances, est le fait de la
victime. Dans le cas des inondations, les habitants travaillent
à leur sécurité avec le souvenir des crues,
directement vécues, ou racontées par leurs proches.
Cela alimente leurs critiques des mesures techniques
de prévention qu’on leur propose, surtout quand
cellesci se révèlent inefficaces (François Duchêne et
Christelle Morel Journel).
Ce hiatus est particulièrement sensible dans le cas
où l’hégémonie de l’entreprise, d’intérêt public comme
la Cogéma à La Hague, est quasi totale. Les élus sont
des salariés de l’entreprise, l’essentiel de la taxe professionnelle
vient d’elle, les productions agricoles sont
dévalorisées par le risque de contamination. C’est la
visite du site par les touristes qui apporte un peu de
ressources nouvelles. Le risque nucléaire détermine
une nouvelle image des lieux. Il ne reste plus qu’à
vivre fièrement comme si de rien n’était, dans un fatalisme
héroïque qui délégitime la médiation des élus
locaux (Laurent Bocéno).
Rapportés au territoire local par la responsabilité
politique croissante des communes, les risques en
viennent à faire réseau et leur somme à atteindre une
cote d’alerte d’autant plus inquiétante que prévention
et secours étaient jusqu’à présent gérés par l’État. Les
habitants sont invités à prendre euxmêmes des
mesures de précaution et à renoncer à des pratiques
séculaires comme la cueillette des champignons, la
récolte des fruits de mer, l’agrandissement de leur
maison, ou l’usage de leurs caves. La certitude du danger
les mobilise même plus s’ils sont loin de son épicentre.
Ingénieurs et sociologues s’interrogent sur
cette diversification des risques, sur l’abandon de la
figure du progrès (Philippe Genestier et Laurette Wittner).
La police suit le mouvement, et se réorganise pour
intellectualiser son travail comme les autres branches
de l’industrie. Elle reprend conscience de son matériau
originel : la vie quotidienne dans la ville. Les habitants
sont invités à policer leurs comportements pour ne
pas produire d’accidents, sur le chemin de l’école
notamment (Jérôme Ferret).
L’individu moderne est inquiet, il éprouve des difficultés
à se repérer, à gérer son identité, d’autant qu’il
déménage souvent ; il ressent l’étranger là où il s’installe,
et séjourne, comme une menace. Il aspire alors à
s’établir dans une cité fermée ou à sentir sur lui le
regard d’une caméra video, et à se garantir qu’il n’est
entouré que de gens comme lui. Son logement, en
pleine propriété ou en accession, devient alors, son
seul espace de liberté assuré (François Madoré).
Contrairement à ce que nous croyons, cette passion
pour les cités fermées ne triomphe pas aux ÉtatsUnis,
même si elle est y très présente ; certaines collectivités
locales se sont aperçues qu’une gestion très affirmée
des espaces publics, soulignant notamment la différence
avec les espaces privés, était encore plus efficace.
La visibilité généralisée donne à chacun la certitude
d’un contrôle latent (Gérald Billard).
Cette certitude, qu’Anthony Giddens appelle la
sécurité ontologique, est fortement ébranlée lorsqu’un
quartier calme, comme celui dont nous parle Franck
Sanselme, accueille soudain de nouvelles pratiquantes
du métier le plus vieux du monde. Le face à
face catastrophique est alors entre humains déjà là et
humains arrivant nouvellement. Norbert Elias a montré
que cela donne lieu en toutes circonstances à des
logiques d’exclusion.
Pourquoi s’inquiéter ainsi, demande Thierry Pillon.
Une société inventive et progressiste est toujours une
échappée d’un ordonnancement unitaire ; celuici ne
peut se fonder qu’en religion. L’hétérogénéité croissante
des lignes de vie crée évidemment des tensions
et des besoins d’arrangement. Mais la modernité
consiste à se rendre capable d’y veiller dans leur pluralité,
de manière décentralisée.
Un espace public où « la sécurité ontologique »
serait totale et le risque de rencontre d’étrangers
inexistant serait particulièrement ennuyeux, et provoquerait
la fuite quelle que soit sa beauté et sa fonctionnalité.
Si les habitants revendiquent une plus
grande homogénéité c’est qu’ils supportent l’incertitude
aujourd’hui dans leur carrière professionnelle.
Du coup la demande de sécurité se reporte sur l’espace,
ici et maintenant. C’est l’habitat, et non plus le
statut professionnel, qui doit offrir un ancrage à la
prise de risques. La tendance est alors à la multiplication
des clôtures et à l’homogénéisation des fréquentations.
L’urbanité appelle une autre politique des
espaces publics (Harmut Haüssermann).
Peuton imaginer ainsi une ville qui se risque à
apprendre des uns et des autres, propose Isabelle
Stengers, une ville qui se construit dans la reconnaissance
réciproque ? Relativiser les dangers, prendre des
risques calculés, le faire en coopération avec d’autres,
élargirait les capacités collectives, augmenterait la
puissance d’agir et les occasions de joie. L’horizon
repoussé à nouveau découvrirait des espaces d’invention
où il ferait bon s’aventurer, en prenant le risque
d’apprendre quelque chose.
Anne Querrien